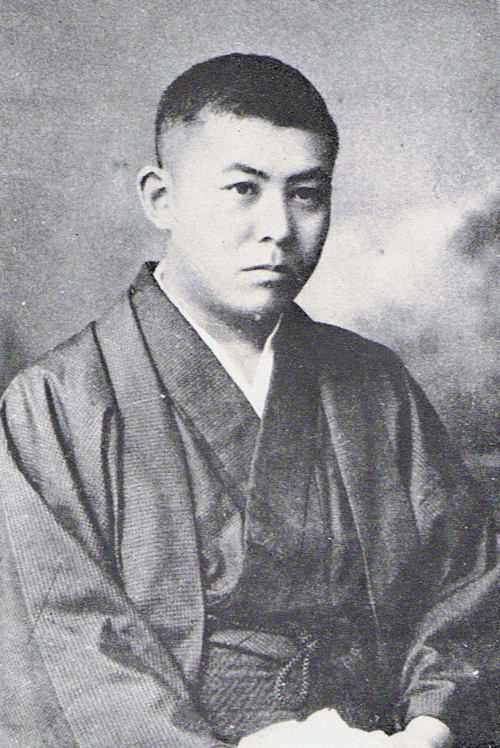Sortant d’un profond sommeil qui n’en
était pas un, la première chose que j’entendis s’apparentait à un long
meuglement.

D’une brume irréelle, de ces brouillards presque surnaturels

qui
empêchent de distinguer le paysage et l’environnement, une silhouette
quadrupède ne tarda pas à se détacher, du moins la distinguai-je ainsi.
L’animal s’apparentait aux bovins, buffle d’eau ou bœuf musqué. Au fur et à
mesure que s’égrenaient les parcelles de temps, la créature ne cessa de se
préciser. Aussi m’apparut-elle, toujours meuglant, bête cornue et laineuse, à
la fourrure emberlificotée, emmêlée de festons de givre, attachée à je ne
savais quoi par un licou, harnachée d’une espèce de couverture matelassée ornée
de grelots dont les tintements ajoutaient à l’atmosphère fantomatique et
déconcertante du spectacle. Il s’agissait d’un yack, bête de somme et de bât fort commune dans les contrées les
plus reculées et montagnardes de l’Asie.

L’animal sentait fort, exhalant des
remugles de bouse mêlée aux miasmes du beurre rance. Son haleine gâtée émettait
force fumée, car en ce lieu régnait un froid prenant. Chose curieuse : il
ne me tourmentait point, ne provoquait pas onglée et engelures.
Au-delà de ce buffle puant, mes yeux
distinguèrent quelque cahute sommaire, au seuil de laquelle se dressaient trois
personnages singuliers, revêtus d’un agrégat hétéroclite de peaux au-dessous
desquelles était drapée une robe de teinte safran. Bien que chacun fût nu-tête,
aucun n’avait rasé son crâne. Malgré la froidure conséquente, le trio était
chaussé de simples sandales. Tous m’ayant aperçu, chacun me salua.

Ces « bonzes » de Bouddha –
ainsi supposais-je leur qualité – appartenaient à toutes les races de la Terre
exceptée la nôtre.
A ma gauche, le plus âgé d’entre eux
s’apparentait à un Peau-Rouge, quoique sa face burinée de vieillard ne fût
ornée d’aucun signe symbolique peint, et que nulle plume d’apparat ne vînt
coiffer sa tête à la chevelure blanchie. Il m’adressa la parole, se courbant
avec solennité. Sans que je connusse un traître mot de la langue dans laquelle
il s’exprimait – était-ce là l’effet du « traducteur universel » du
Sélénite porcin ? – je compris tout ce qu’il me disait.

« Bienvenue étranger. Je me nomme
Lobsang Jacinto. »
A ma droite immédiate, encadré par ses
deux compagnons, le deuxième moine parla à son tour :
« Mon nom est Tenzin
Musuweni. »
Il s’agissait d’un Africain, non pas
de quelque esclave des Isles ou d’Amérique, non pas non plus de quelque membre
d’une tribu belliqueuse, mais d’un bonze à la peau noire, natif du Congo, qui
se fût acclimaté au Thibet. C’était un homme dans la force de l’âge, le seul
qui arborât une barbe et une moustache discrètes, cependant non pas coupées à
la chinoise. Ses traits nobles rappelaient quelque étude de Rembrandt van Rijn.

Après que Tenzin Musuweni se fut
incliné, le troisième moine, qui était le plus jeune et semblait plus nerveux
que les autres, se présenta enfin.
« Je m’appelle Raeva Rimpotché,
et je fais office de barde et de rhapsode, ainsi qu’en témoigne l’instrument à
boyaux fixé à mon dos. »
L’homme, parfaitement glabre et le
cheveu court, appartenait aux isles du Paradis, au peuple des « bons
sauvages » qui tant fascina nos grands navigateurs Bougainville, Cook et
La Pérouse. Mais sa peau apparaissait vierge de tout tatouage.

« Ami étranger, reprit celui qui
se qualifiait de Lobsang Jacinto, sois le bienvenu dans le monde universel du
Gautama Sakyamuni. Les lois de l’hospitalité nous imposent que nous te fassions
bon accueil, mais nous avons aussi pour devoir de te juger. Nous savons que tes
fautes sont graves. »
Remarquant au fond de la hutte quelque
autel surmonté d’une statue de Bouddha sans nul doute en bois recouvert de
feuilles d’or, je répondis au vieil Indien.
« Exigeriez-vous qu’au préalable,
je fisse amende honorable et que je me prosternasse devant celui que vous
dénommez avec pertinence le Gautama Sakyamuni ? »

A mes paroles, Lobsang Jacinto ne
cilla aucunement. Sa bouche ne cela rien et l’impassibilité énigmatique propre
à son peuple témoigna d’une absence d’émotions.
« La confession chrétienne des
fautes nous est étrangère, répliqua-t-il.
- Nous n’avons que faire des états
d’âme de ce cynique débauché qui ne croit même pas à son propre Dieu !
jeta sarcastique Raeva Rimpotché.
- Qu’il puisse tout de même exposer
ses fautes avant que nous prononcions la sentence », observa Tenzin
Muzuweni.
Sans jamais mentir – je ne pouvais me
le permettre face à un tel tribunal -, sans même omettre mes vices, je dévoilai
toute ma vie, aussi bâtie de
turpitudes qu’elle fût. J’usai avec le trio de pieux hommes de la franchise la
plus limpide. D’un ton imprécatoire après qu’il eut écouté sans jamais frémir
l’exposé de mes pires crimes, Lobsang Jacinto débuta mon interrogatoire. Un
interrogatoire complémentaire, qui consistait à confirmer mes dires, à dater
avec précision mes mauvaises actions, mes trahisons politiques multiples, mes
déloyautés successives à l’encontre de Louis le seizième et du duc d’Orléans,
jusqu’à ma manière de ruser avec Napoléon. Devant cet étalage franc, qu’il crut
sur parole, ce vénérable consulta du regard ses deux acolytes qui, d’un geste
de la tête ou des mains, lui firent comprendre qu’ils ne sollicitaient de ma
part aucun supplément de mots, tant ma cause était limpide en toutes ses
turpitudes. Alors, Lobsang Jacinto m’annonça le verdict. A l’écart, le yack
chimérique émit un meuglement d’acquiescement du choix du vieil Indien.

Les sentences anathématiques que ce
dernier prononça à mon encontre, énoncées implacablement tels des chefs
d’accusation énumérés en un procès hypothétique d’un Napoléon le Grand détrôné,
me firent frémir. Dramatiques, déclamatoires même, elles eussent pu rappeler
quelque chant de sorcier, coiffé et masqué d’un heaume d’écorce bariolé,
entonné lors d’une de ces danses de la pluie commune aux tribus d’Amérique. Contus,
l’esprit confus, je rougis au rappel de ces « péchés » qui me
condamnaient à une version sauvage de l’Enfer, à une damnation éternelle
païenne. Si je me plaçais du point de vue terrestre et séculier, ipso facto,
cette condamnation, aussi exotique qu’elle fût, équivalait à une disgrâce et un
embastillement perpétuels. Encore jurais-je que le plus jeune de mes juges, ce
Raeva de mauvais aloi, souhaitait ma mort. Il paraissait contrarié, prêt à
contredire le patriarche indien.
Afin d’échapper à l’exécution de la
sentence des bonzes, je disposais d’un unique atout dans ma manche, le Baphomet
lui-même, encore eût-il fallu que mes juges me permissent de le rejoindre. Il
me suffisait de m’esquiver à leur nez et à leur barbe, en espérant que mon
pied-bot n’handicapât pas ma course ! En posant un simple doigt – peu
importait lequel – sur le symbole adéquat, à savoir l’aigle et la couronne de
lauriers, je m’évaporerais et reviendrais à Milan, du moins le supposais-je. Mais
le Marnousien avait bien gardé de me suivre et j’en étais marri.
J’attendis l’instant propice, sans que
ces moines exotiques eussent le moindre geste à mon encontre en s’emparant de
moi afin de me transporter en leur version des Champs Phlégréens.

Quelle que se
fût présentée leur geôle, elle n’aurait pu être pire qu’un in-pace. A cet
instant d’incertitude, le yack émit un meuglement différent de l’ordinaire.
Lorsque je vis surgir de la brume une personne incongrue qui se porta à ma
rencontre, je compris que le bovin, telles les oies sacrées du Capitole, avait
sonné l’alarme, signalant au trio une intrusion étrangère, indésirable.

Une personne familière à la cour
royale apparut et je m’écriai :
« Comte di Fabbrini ! »
Je fis erreur sur l’identité de
l’importun, tant il semblait le sosie du sieur Galeazzo.
« Vous vous trompez, Monsieur de
Talleyrand, mais votre méprise est excusable, me répondit-il. Je me nomme
Johann van der Zelden, celui grâce à qui le monde que vous connaissez
existe ! »
Etait-il un vantard ? Ses
vêtements, uniformément sombres, le drapaient comme un oiseau de nuit.
J’éprouvais de la peine à soutenir son regard de ténèbres. L’homme était armé
d’un de ces nouveaux pistolets à barillet et menaçait les bonzes. Il osa se
saisir du plus âgé d’entre eux, ce Lobsang Jacinto, le plus sage de ce trio de
juges, presque à le molester, offrant la tempe de ce vieillard à la convoitise
du canon de son colt. L’homme, impavide, ne frémit même pas, quoique sa vie ne
tînt plus qu’à un fil.
« Vous allez m’obéir et me
restituer votre otage ! » jeta le mystérieux Hollandais d’une voix
ferme.
Ils se montrèrent plus pacifiques et
coopératifs que je le redoutais. De guerre lasse, ils renoncèrent, me laissant
entre les mains de ce Deus ex machina de tragédie archaïque, jumeau improbable
du comte. Demeurant mutiques et impavides, ils ne nous adressèrent plus le
moindre regard.
« La non-violence les
perdra », dit le sieur van der Zelden avec une ironie teintée de
fatalisme. Il crut bon d’ajouter avec théâtralité : « Veuillez me
suivre, Monseigneur. »
Je ne me fis pas attendre, bien que je
jugeasse l’intervention de cet alter-ego par trop providentielle. Le Baphomet
nous attendait bien sagement au bout du chemin ; je n’eus qu’à laisser le
sosie ou jumeau du comte appuyer sur le bon symbole de la ceinture – l’aigle
couronné de lauriers – pour que l’androïde nous transportât non sans heurts
vers notre monde familier. Sitôt parvenus à destination, mon sauveur s’éclipsa
de la salle, se fondant dans l’obscurité, sans même qu’il eût prêté attention
au Sélénite porcin, que mon retour indemne surprit à peine ! La
préservation de l’anonymat du Hollandais lui était indispensable. Sans doute se
faisait-il souvent passer pour di Fabbrini afin qu’on ne l’inquiétât pas. La
nuit était venue depuis long-temps, et il n’y avait plus âme qui vive à part le
pseudo-nain et moi-même.

Sans l’intervention opportune et
salvatrice de ce sieur van der Zelden, sosie improbable du comte di Fabbrini,
c’en eût été fini de moi. J’aurais achevé mes jours en quelque yourte carcérale
puante ou pis encore, les vautours se seraient repus de mes chairs découpées et
disséquées après mon exécution supposée.

Cependant, la machine demeurait en
place, et ma mission ne pouvait s’achever ainsi. Aussi me tournai-je vers mon
extraterrestre afin de trouver la bonne solution : il n’était pas question
que Murat s’emparât du Baphomet et le ramenât en France comme une œuvre d’art
pillée ! Nous n’étions pas en guerre contre Milan ! L’« extraterrestre »
me fit promettre de ne pas utiliser El
Turco à de mauvais desseins si jamais il venait à tomber entre les mains de
Napoléon.
Pourtant, en contrepartie, je lui
demandai de me dessiner les plans de l’automate et de me dresser la liste de
chacun des symboles vestimentaires et motifs de la ceinture, liste accompagnée
de croquis les reproduisant scrupuleusement, même les plus incongrus et saugrenus,
avec leur signification et leur destination. Nous convînmes d’un rendez-vous
pour la remise de ces documents, les seuls à même de me satisfaire, en espérant
que nos mécaniciens et ingénieurs es arts se casseraient les dents en voulant reproduire l’androïde comme arme. De
mon côté, je fis jurer à mon succédané de sanglier parlant venu de Jupiter ou
d’ailleurs – où donc était l’astre Marnous ? - de ne jamais parler de
cette nuit à quiconque et de ne point trahir le secret ni aux Anglais, ni aux
Bourbons, ni à d’autres ennemis de la France.

Ceci fait, je pris congé, rejoignant
les lieux où logeait mon ambassade. Tout en méditant sur les paroles
mystérieuses de ce Johann prétendant être à l’origine de notre monde, je
m’alitai enfin.
Je me promis qu’un jour, sceau du
secret ou pas, Napoléon se mesurerait en personne à El Turco comme autrefois
Catherine la Grande, fût-ce à Milan même.
Petite interruption de l’auteur :
cette partie d’échec se déroulera certes à Milan, mais pas avant 1808. Nous
vous la conterons dans un chapitre ultérieur.
A suivre ...
*****