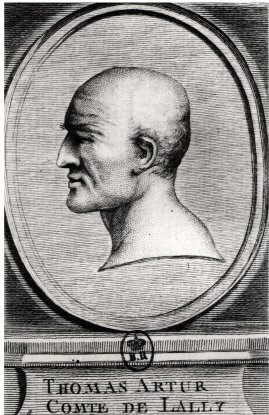The Magnificent King of Scots, soi-disant Outarde rayonnante, filait à pleines voiles et à toute vapeur vers son destin. La frégate maquillée en brick-goélette filait bien ses douze nœuds, vitesse remarquable pour l’époque. Sachant que la distance jusqu’à Douvres par la voie du Channel était à peine de vingt-et-un milles nautiques, le capitaine, confiant en son navire, pouvait estimer que la destination serait atteinte avant l’après-midi.
La hune de la vigie du grand mât

servait aussi de sémaphore, un sémaphore certes plus petit, et uniquement équipé d’un télégraphe mécanique à bras enrichi d’un système de miroirs. Cette même vigie avait reçu l’ordre de transmettre en langage codé à Douvres l’approche de l’unité. Au plus haut des falaises était érigée la structure nécessaire à la réception du message, falaises colorées d’albâtre que l’on apercevait déjà à l’horizon. La vigie s’exécuta, mais son regard aquilin remarqua qu’un aérostat suspect et amarré à une bouée se trouvait là, à onze heures, à une altitude d’environ sept cents mètres au-dessus des eaux, soit un peu moins de 2300 pieds. C’était là le premier obstacle à éliminer pour franchir la barrière du blocus. A l’aérostat gonflé à l’hydrogène flottait la nouvelle bannière royale honnie. L’on savait les aérostiers de Buonaparte redoutables : loin de se limiter à des tâches d’observation, ils étaient équipés de canons de petit calibre et de Gatling capables d’abîmer sérieusement voilures et coques, même renforcées d’acier. De son côté, l’aménagement de la hune en poste de tir aérien avancé imposait qu’elle fût dotée d’un système de coupole protectrice rétractable, prescience ou anticipation des positions des mitrailleurs des bombardiers du XXe siècle. Il ne manquait à l’attirail de la vigie que le masque stratosphérique et la calotte de cuir.

L’homme avait abaissé la coupole blindée,
juste à temps, car une première salve en provenance du ballon ennemi arrosa le
grand mât. Celle-ci demeurait encore imprécise, mais les artilleurs
napoléonides allaient ajuster leur tir. Trois options s’offraient à la riposte
de la vigie-hunier : soit viser la godille ou gouvernail de l’aérostat
afin de le déstabiliser, soit concentrer le feu sur la nacelle, en fauchant les
servants et en tranchant les câbles qui la maintenaient en place via l’arrosage
des rafales du canon à mitraille dont il disposait, soit, enfin, viser
exclusivement l’enveloppe du ballon afin d’en faire une passoire qui perdrait
son gaz, et se dégonflerait avant d’exploser.
Une deuxième salve, plus précise, frappa
le pont et le gaillard d’avant, occasionnant des dommages aux haubans du mât de
misaine et blessant plusieurs matelots. L’un d’eux bascula du bastingage à la
mer. Les pièces des sabords étaient hors-jeu dans ce combat mer-air !
Le hunier dut calculer rapidement l’axe de
pointage de son canon : trop bas, il manquerait sa cible ; trop haut,
il ne ferait qu’effleurer l’enveloppe du ballon ennemi, dont la gutta-percha
était gainée d’un réticule serré de chanvre doublé d’acier qui semblait la
protéger efficacement. Il mitrailla d’abord les canonniers, non pas qu’il
espérât les neutraliser, mais dans l’objectif de les distraire. Il venait
d’opter pour un tir concentré sur l’enveloppe, à condition qu’il ne finît pas
par manquer de munitions.
Les soldats de l’usurpateur interceptèrent
le premier jet de mitraille ; un sergent fut blessé à l’épaule, mais
l’officier chef de bord ordonna aussitôt le délestage de l’aérostat puis
actionna la soupape. Tandis que quatre sacs de sable chutaient dans le Channel avec des plops horripilants, le
ballon bondit dans le ciel de deux cents pieds, ce qui permit à la nacelle de
surplomber nettement le grand mât et aux artilleurs de cibler exclusivement la
hune blindée.
L’héroïque hunier-artilleur subit
stoïquement le flux métallifère vicieux qui perça promptement la coupole de ses
projectiles cylindro-coniques chargés de fulmicoton, tirés d’un hybride de
mitrailleuse et de mortier. Hurlant de rage et de douleur, sanguinolent, percé
de coups, notre gars originaire du Lincolnshire, un vétéran qui avait participé
côté loyaliste à la guerre d’indépendance des Etats-Unis, assena une ultime
rafale à la nacelle des séides de Buonaparte, rafale suffisante pour rompre
deux câbles, trouer la partie inférieure de l’enveloppe et abattre deux
servants. Il succomba, alors que l’adversaire, touché mais point vaincu,
disposait encore d’une grande faculté de nuisance. Le masque buriné du guerrier
de la mer se figea à jamais, une ultime balle explosive ayant broyé son cœur.
Ce fut alors qu’un spectacle extraordinaire s’offrit aux marins d’Albion. Surgissant d’une écoutille, Georges Cadoudal se précipita sur le grand mât et, aussi agile et impressionnant qu’un mâle dominant orang-outan de Bornéo, escalada les haubans, sauta de vergue en vergue, d’espar en espar, jusqu’à parvenir au poste de vigie dont il releva la coupole transpercée devenue inutile. Alors, profitant d’une accalmie ennemie, il rechargea la pièce d’artillerie du malheureux héros et, tout en jurant à tue-tête « Par Sainte Anne d’Auray ! » visa l’enveloppe de l’aérostat français en un tir ininterrompu.

De sa lunette, l’officier du ballon avait
vu ce colosse prendre la place du mort, mais il n’eut pas le temps de donner un
contrordre qu’un jet fusant transperça tout : nacelle, hommes et
gutta-percha, ce malgré le filet renforcé d’acier. Mauvais présage : la
bannière napoléonide, lacérée, déchiquetée, tomba. Les Français succombèrent,
métamorphosés en paquets sanglants, alors que l’enveloppe, affaiblie, trouée de
toute part, finit par laisser échapper l’hydrogène délétère qui explosa en une
boule flammée d’écarlate. L’aérostat captif, horrible torche aérienne, sans
qu’on eût eu le temps de supposer qu’à bord demeuraient encore des survivants
simplement blessés qui se voyaient mourir flambés, s’abattit de tout son haut,
rompant même l’amarre qui l’attachait à la bouée qui eût mérité qu’on lui
prêtât davantage attention.
Cette amarre-bouée était un piège mécanique habile et inédit, une invention perverse des ingénieurs dévoyés dévoués à Galeazzo, qui avait de la suite dans les idées lorsqu’il s’agissait de montrer son génie dans les arts de la guerre. Se détendant, s’ouvrant comme la poche du bec d’un pélican, elle éjecta par dizaines de curieux objets flottants, invraisemblables, d’un noir d’anthracite et hérissés de petites pointes, copies humaines des oursins, plus précisément du peuple extraterrestre des oursinoïdes d’Ankraks. Ces oursins artificiels s’en vinrent se propulser en direction de la coque du Magnificent King of Scots, comme mus par un aimant.
« Quelle est donc cette
diablerie ? s’exclama le capitaine Burke.
- Les champs de mines-flottantes
oursins ! Je pensais cette arme secrète conjecturale, simplement au stade
du prototype ! répondit Maël.
- Oh
my Lord ! Que Dieu nous vienne en aide ! »
*********
Deux unités venaient d’appareiller incognito de l’arsenal de Calais. L’on devine que l’une d’elles n’était autre que le sinistre steamer cuirassé de type Merrimack Amiral Villaret de Joyeuse armé de six canons Columbiad. L’autre représentait ces submersibles d’avenir, dérivés de l’engin de l’Américain Fulton, mais en plus grand, avec son étrange voile dorsale reproduisant la nageoire du même type, anticipation du Nautilus de Jules Verne, ainsi imaginé par le comte di Fabbrini qui avait œuvré à l’amélioration du prototype originel de la piste temporelle primitive. A son bord, outre l’équipage, se trouvaient Stanislas Fréron et son accompagnateur bédouin ou targui, en route pour l’Angleterre.
Le compte rendu du rescapé de la pseudo-Outarde, épluché par le commandement du
port, avait permis de déterminer l’objectif du Merrimack : désormais, la cible avait un type et un nom, même
faux et usurpé. Bien que les amiraux supposassent que les défenses du blocus (ballons
et mines) pourraient rendre superflue la mission du cuirassé, le gouverneur de
La Trémoille avait la conviction que l’adversaire loyaliste disposait de plus
d’un tour dans son sac, étant puissamment appuyé par les Anglais. Il suffirait
que le commandement suprême de l’Amirauté de Londres intervînt, engageant
l’amiral Horatio Nelson en personne, pour que le nouveau gouvernement de
Napoléon fût gravement freiné dans ses ambitions hégémoniques.
Cependant, Fréron avait exposé à La
Trémoille ses objectifs ultra secrets : déstabiliser l’Angleterre de
l’intérieur par les sabotages, les assassinats ciblés d’ingénieurs militaires
et l’art de fomenter des désordres sociaux pour lesquels un nom de ralliement
avait été forgé : John Ludd. La Trémoille se doutait toutefois que Fréron
agirait davantage au bénéfice politique de Danton qu’au renforcement de la
nouvelle dynastie, mais tout ce qui permettrait d’abattre l’ennemi héréditaire qui nous nuisait depuis la Glorieuse
Révolution de Guillaume III serait le bienvenu. Quant au dernier représentant
des prétendants jacobites, un cardinal médiocre, il croupissait à la Tour de
Londres sans avoir pu participer au dernier conclave, à Venise, qui venait
d’élire le falot Pie VII. La méthode, la stratégie de Danton, avaient peut-être
plus de chance de succès que celle de Napoléon. Conseillé par Talleyrand, le
roi non encore affermi avait préféré concentrer la lutte contre les colonies
anglaises (d’où l’indépendance de la Jamaïque déjà évoquée) et préparait la
double rébellion des Irlandais et des Ecossais, tandis que le prince-régent
allié à la fougue juvénile de Madame Royale, espérait plus que jamais en les
proches sécessions de la Bretagne, de la Vendée, du Poitou et de la Provence.
Charles Maurice de Talleyrand-Périgord
avait quant à lui mal pris les nouvelles instructions de Napoléon :
retrouver l’abbé de Firmont outre-Manche, objectif classé comme prioritaire,
lui semblait une mission futile, de peu d’utilité, à moins que ce confesseur
irlandais, déjà âgé, fût destiné à devenir le fer de lance de la révolte
d’Erin. Enfin, percer le mystère du Baphomet s’apparentait davantage à de
l’occultisme, de l’illumination, qu’à la mise en service de l’improbable arme absolue. Les données dont disposait
le ministère des Affaires extérieures, fournies par nos services secrets,
avaient localisé un curieux automate joueur d’échecs dont les pérégrinations
foraines allaient de l’Autriche à la Bavière puis au Milanais : El Turco. Selon Napoléon, l’arme absolue consisterait en un couplage entre
cet automate et la momie de Langdarma. Encore fallait-il monter l’expédition du
Mustang. Or, deux espions du monarque venaient d’être envoyés aux Amériques,
afin d’appréhender le grand explorateur Humboldt, qui venait de débarquer sur
les côtes du Venezuela, pour ensuite le convaincre de diriger ladite expédition
népalaise. De quels moyens coercitifs illégaux allaient-ils donc user ?
Ce fut à bord d’un second submersible
Fulton que Talleyrand appareilla à son tour pour Albion, mais à Boulogne.
**********
Les mines-oursins flottantes étaient
irrésistiblement aimantées vers la coque ferrée et cuivrée du faux
brick-goélette. L’espoir d’échapper à d’effroyables explosions en chaîne
paraissait aussi mince qu’une feuille de papier de tabac à rouler. Trois
sinistres hérissons d’obsidienne s’en vinrent se plaquer, adhérer à tribord,
juste au-dessus de la ligne de flottaison. Ils émettaient d’angoissants tic-tac
car leur détonateur était doté d’une minuterie issue du perfectionnement du
chronomètre Breguet. Même en relevant les sabords, même en essayant de pointer
les pièces d’artillerie en plongée, chose inhabituelle, même en optant pour le
tir à boulets rouges ou à boulets ramés, les artilleurs du capitaine Burke,
aussi experts qu’ils fussent, n’avaient aucune chance de neutraliser les
mines-oursins ; pire : ils déclencheraient leur explosion anticipée.
La charge explosive était protégée à l’intérieur de la carapace de ces monstres
mécaniques épineux acérés ; il ne fallait pas espérer que leur nage dans
l’eau de mer altérât leur fonctionnement.
Adonc se produisit une première déflagration, qui pulvérisa deux sabords inférieurs de tribord et occasionna une voie d’eau. Deux artilleurs furent occis sur le coup, un troisième eut les jambes arrachées, sans oublier une dizaine de blessés coupés et éborgnés par les innombrables échardes et les éclats des plaques métalliques qui renforçaient la coque.

« Les pompes ! les
pompes ! » hurla le second.
Trois oursins supplémentaires dardés
adhérèrent à la poupe, menaçant le gouvernail et l’hélice dont nous avons
tantôt parlé. Burke ordonna : « Bâbord amures ! » afin
d’empêcher les mines d’attaquer l’autre flanc du navire. Cela eût équivalu à un
éperonnage à bâbord. Le changement d’amure impliquait que l’unité virât lof pour
lof. La manœuvre semblait désespérée, d’autant plus que les voiles carrées ne
la facilitaient pas. Hélas, bien qu’elle fût couronnée de réussite grâce aux
efforts conjugués de titans des marins et soutiers qui poussèrent à toute
vapeur la chaudière, les diaboliques mines piquetées, comme dotées d’intelligence, suivirent le mouvement du faux brick,
l’accompagnant comme un chien fidèle.
En bas, l’on s’acharnait à pomper ce qui
pouvait l’être, à évacuer cette eau maudite qui se déversait en flux hideux par
la brèche d’éventration des postes d’artillerie. L’homme aux jambes arrachées
était mort, et son corps mutilé transporté en vain à l’infirmerie de bord. Les
héroïques flibustiers ou réguliers de la Royal
Navy entonnaient à tue-tête des chants triviaux afin de se donner du
courage, couvrant de leurs voix rauques, enivrées de tafia, galvanisantes, le
bruit entêtant de la pompe mécanique, le mouvement sans fin de ses bras qui la
rendaient semblable à quelque insecte semi-aquatique à la chitine ferreuse.
Alors se produisit la deuxième
déflagration, qui lésa le gaillard et le château arrière, là où se situaient
les quartiers du commandant et de ses officiers. Toute la structure du Magnificent King of Scots fut ébranlée.
Le vaisseau craqua, les gréements tremblèrent, oscillèrent, comme proches
d’être abattus par un séisme marin. Des nuées d’écume aspergèrent les ponts,
les écoutilles, éclaboussant tout ce qui s’y trouvait. Le navire chaloupa et
commença de gîter, privé de gouvernail et de boussole.
Un cri non identifiable, humain ou
bestial, stridula. Une silhouette furieuse émergea en surface, comme éjectée
des cales, Erinye hystérique, harpie démente, tumescente d’hubris. Elle
s’agitait toute, brandissant une paire de pistolets, hirsute, l’habit de voyage
à demi arraché, pendeloquant telles des guenilles squameuses, dévoilant une
gorge impudique et pellucide de juvénile Vénus du style grec sévère.
C’était Félicitée Flavie. Toupinant sur
ses jupes et jupons qui friselisaient et froufroutaient à la diablesse, se moquant
de son impudicité, elle se pencha au bastingage de bâbord qui gitait plus que
jamais, au risque qu’elle chût en pleine mer puis, ajustant ses armes de poing,
tira à bout portant sur une harde d’oursins de suie, les criblant de
projectiles explosifs, provoquant leur éclatement prématuré avant qu’ils se
collassent à la coque, puis, gloussant, satisfaite de son exploit, d’un rire
déraisonné enfantin et malséant.
« Nous vaincrons, messieurs, nous
vaincrons ! » scanda-t-elle hallucinée, ses yeux roulant en ses
orbites.
Maël et Cadoudal venaient de trouver une
autre parade, plus destinée à retarder le naufrage qu’à annihiler
définitivement les mines qui pullulaient comme des rats dans une Cloaca non
curée. Elles accouraient de toute part, venues de toutes les directions
cardinales, obéissant au signal de leurs compagnes de l’avant-garde. C’était
une nouvelle société d’insectes, de fourmis pélagiques et benthiques,
caparaçonnées d’armures hérissées de pointes empoisonnées, fléaux d’armes
nageurs. Elles témoignaient d’une sorte de cognition cybernétique, d’intelligence
non biologique, digne des nanites de l’Empire Olphéan. Elles représentaient une
race nouvelle d’archidémons synthétiques, acheiropoïètes, robotique baroque
jaillie non plus des méninges industrieuses du Maudit mais de son mentor non
humain, la Mort Johann van der Zelden, donateur du translateur temporel par
lequel Galeazzo avait pu mettre ce monde dévié en route. Les piquants noirs,
comme enchâssés en leur cuirasse, enracinés en bulbes et follicules pileux
rigides, paraissaient exsuder, transsuder, suer, un curare foudroyant. Ces
oursins demeureraient-ils invaincus ?
Faisant fi du délire de Félicitée Flavie,
dépoitraillée et décoiffée, qui avait vidé ses pistolets, Maël et Georges,
porteurs de fûts d’acide (on se demandait à quoi eût pu servir une telle
marchandise de contrebande, si ce n’était aux chimistes des arsenaux de la
Navy), les ouvrirent et déversèrent sans hésiter leur contenu sur les mines
infernales, supposant que cet acide suffirait à ronger les carapaces et le
mécanisme interne, rendant détonateur et explosif inopérants. Une partie du
liquide se perdait en jets fumants manquant leurs cibles mouvantes. Les
monstres étaient malins, vicieux ; ils faisaient des écarts incessants,
mais, lorsque les deux loyalistes atteignaient leur but, les bêtes se désagrégeait en fumerolles
blanchâtres et braisillantes, en émettant comme un cri crépitant d’agonie. Il
était évident qu’elles souffraient.
La structure ou test mise à nu, l’oursin extraterrestre sombrait, mort, sans demander son reste.
Nombreux furent ses semblables qui
succombèrent d’une pareille façon, en des solfatares et geysers acidulés
brûlants, jaillissant d’une carapace dissoute par l’acidification, transmutée
en un lait de chaux bulleux, phénomène chimique qui n’était pas sans évoquer
l’extinction massive supposée des espèces océaniques pourvues de carapaces et
téguments durs, des radiolaires aux trilobites, à la fin du Permien. Toutes ces
vapeurs portées à ébullition, tous ces gaz de chaux, engendrèrent une brume
bouillante, sudorifique, qui enveloppa le Magnificent
King of Scots, brume irrespirable apparentée à un smog acide comme pouvait
en produire le Londres industriel. Gare à ceux demeurant à l’air libre !
Si Maël, Cadoudal, le capitaine et Félicitée Flavie comprirent qu’il leur
fallait redescendre dans les soutes, quelques imprudents marins demeurèrent sur
le pont, s’étouffant et crachant leurs poumons en lambeaux histologiques
sanglants, mourant en moins de deux minutes. Leur toux horrible retentit de la
proue à la poupe.
Comme pour parachever le cauchemar, un
bruit émergea du brouillard. Ce n’était pas là une corne de brume mais quelque
mugissement étrange, trémulant et sourd, animal peut-être. Cela s’apparentait
au chant de quelque prédateur, d’un cétacé singulier, d’un rorqual
antédiluvien, sonar d’un Basilosaurus ou Zeuglodon tertiaire, à moins qu’il se
fût agi de quelque cri de prédation émis par un Elasmosaure encore plus
préhistorique.
L’autre Bête se montra enfin, surgie du smog, titanesque. Tortue
disproportionnée, bosselée de concrétions rappelant des tourelles, concrétions
desquelles pointaient, ithyphalliques, des bouches rigides et creuses ;
tortue crénelée, mue par le feu, filant ses quinze nœuds, à la carapace d’acier
teintée d’une nuance rouille dysharmonique, à l’éperon-rostre agressif et
aiguisé, aux pièces de Columbiad prêtes à éjecter leurs obus létaux.
« Le
Merrimack ! » hurla un officier marinier.
« Canonniers, tous à vos
postes ! » ordonna le capitaine Burke.
***********
Pierre-Simon de Laplace venait d’achever dans les délais impartis par Napoléon son étude de la Telluris Theoria Sacra de Thomas Burnet. Il s’attela à la rédaction du rapport qu’il destinait au nouveau tyran.

Il avait effectué une découverte
fortuite : un manuscrit constitué de lames de cyprès himalayen, rédigé en
une langue asiatique faite de glyphes historiés et bariolés, manuscrit qui
était cousu dans la doublure de la reliure du traité de Burnet. Le chevalier de
Lamarck, féru de botanique, l’avait aidé dans l’analyse et la provenance du
bois, mais l’écrit demeurait indéchiffrable. Cependant, parmi ses enluminures
figurait une série de sphères aux teintes diverses, que Laplace n’hésita pas à
comparer à celles du frontispice de la Telluris.
Il y décela un aspect synoptique, traçant une correspondance entre les
différentes sphères, remarquant, dans son analyse spéculative, une inversion de
la série tibétaine par rapport à celle de Burnet. Pour lui, cela ne faisait
aucun doute : il avait affaire à une cosmogonie, mais, au lieu de partir
de la création de la Terre pour aboutir au globe actuel, les étapes tibétaines
procédaient à l’envers. Tout cela s’apparentait à ce que les Anciens
qualifiaient d’Anacouklesis.
Laplace avait demandé au Maudit de
l’éclairer un peu. Di Fabbrini avait révélé peu de choses, par prudence, si ce
n’était l’influence d’écrits gnostiques et néoplatoniciens, semi-légendaires,
datés entre les principats d’Antonin le Pieux et de Gallien. Il refusa d’en
dire davantage.
Dans son rapport, assez fumeux,
l’astronome usa du mot grec Gaïa, associant
une couleur à chaque sphère, à chaque étape de l’histoire mouvementée de la
Terre. C’était là une clef, encore eût-il fallu connaître la porte qu’elle
ouvrait.
Le savant établit une table de
correspondances multiples, qu’il ne cessait d’enrichir, de complexifier au fil
de sa rédaction alambiquée. L’esprit d’analyse l’emporta sur celui de synthèse,
au risque de l’inintelligibilité. Non content d’associer, par les règles
synoptiques, Burnet et les philosophies orientales, Laplace, sans qu’il comprît
comment – c’était comme si une entité l’eût possédé et lui eût dicté ce qu’il
devait écrire – se hasarda à l’ajout d’une troisième énonciation d’étapes, de
stades, qui, cette fois, concernait la science toute neuve de l’embryologie.
Pour cela, il avait sollicité l’aide de Bichat. Il tint au respect de la
chronologie. Ainsi se trouvèrent associées, appariées, en un raisonnement
épistémologique qui anticipait Ernst Haeckel, les étapes de l’édification de
l’être humain et celles de notre planète. Laplace avait œuvré afin qu’elles
coïncidassent, de la moins avancée à la plus élaborée, de la plus ancienne à la
plus récente. Tant pis pour l’ordre inversé du manuscrit tibétain ! Si
Galeazzo di Fabbrini avait daigné en dévoiler plus à notre futur marquis, il
lui aurait révélé l’existence du codex gnostique intitulé Embruon Theogonia, ouvrage du IIe siècle de notre ère, rédigé par
un philosophe gréco-indien nommé Cléophradès d’Hydaspe. Ce codex appartenait à
toute une série qui permettait, à la lecture de certaines formules oratoires,
l’ouverture de portes vers d’autres univers et d’autres temps. Le Baphomet
lui-même possédait de telles facultés ; Napoléon s’en doutait, Talleyrand
et di Fabbrini le savaient intimement. Chacun usait de faux-semblants, l’un
trompant et bluffant l’autre dans une course effrénée vers le pouvoir absolu,
vers la maîtrise de l’Univers lui-même.
Ainsi, l’importance de la Vénétie, de la
ruine du régime des Doges par les armées de celui qui n’était pas même encore
connétable, seulement puissant général en l’an 1797, cachait un pillage
d’importance : la prise de guerre des codex de Cléophradès…
Napoléon le Grand n’avait su qu’en faire,
mais Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord avait compris d’emblée leur
importance. Les humanités avaient fait le reste : fort de leur traduction,
Talleyrand était parti en quête des derniers représentants de la secte
gnostique en Europe et ces derniers, fait incroyable, l’avaient initié à leurs
secrets et intronisé grand-prêtre ! Cette secte se dénommait pompeusement
Eglise des Tétra-Epiphanes.
Dans l’affaire, Talleyrand avait lésé et
spolié les Habsbourg : la dynastie s’était longtemps transmis la dignité
gnostique, la grande-prêtrise, de l’Espagne à l’Autriche, la déléguant tantôt à
un Grand Inquisiteur, tantôt à un grand dignitaire (comte d’Olivares au XVIIe
siècle, prince de Cellamare ou Cardinal Alberoni au XVIIIe) jusqu’à ce que,
dernière détentrice officielle de cette dignité, Marie-Thérèse y eût renoncé en
1748 au bénéfice non souhaité des Hohenzollern. Frédéric II de Prusse mort en
1786, le « trône » tétra-épiphanique était demeuré vacant onze années.
Le nouveau pape, Pie VII, s’était étonné que Venise fût devenue la plaque
tournante d’un espionnage international très spécial, car y luttaient les
services secrets français, prussiens, autrichiens et russes en quête des
secrets gnostiques.
Laplace avait désormais sous les yeux un
tableau synoptique bariolé délirant auquel il tentait de donner un sens.
Gaïa la noire débutait la série de Burnet, mais affrontait Gaïa la jaune des Tibétains.

Cela gênait d’emblée
Laplace : il eût préféré, sans pouvoir encore l’expliquer, une
correspondance noire-verte, plus logique. Notre astronome qui prétendait se passer
de l’hypothèse de Dieu dans le cosmos se voyait contraint de mettre en
parallèle les versets de la Vulgate consacrés à la Genèse avec ces colonnes de
sphères coloriées reliées à la formation d’un humain. Une gravure médiocre
reproduisant le tapis de Gérone lui avait servi de caution biblique, si l’on
peut l’écrire.
Gaïa la noire incarnait pour l’Occident,
pour Burnet, l’étape primordiale : sphère de ténèbres potentielle, non
constituée, d’avant le Fiat lux, eaux
de jais au-dessus desquelles planait l’esprit de Dieu. Cette planète en devenir
passait au rouge ardent, planète en fusion, à la croûte brûlante, au volcanisme
exacerbé, bombardée de météores qui en faisaient un enfer dépourvu de toute vie
palpable. Or, en face, la Vie était déjà là par les figures successives de
l’œuf fécondé puis de la première division cellulaire, suivie de tant d’autres.
Là était l’exploit insoupçonné de Bichat et Laplace : dans le vrai cours
du temps, ils avaient ignoré la théorie cellulaire, mais Galeazzo, par ses connaissances
futures, la leur avait insufflée, bouleversant ainsi l’histoire des sciences en
donnant à la France, supposait-il, une avance irrattrapable dans le domaine des
sciences de la Vie et de la Nature.
Puis, après des millénaires hypothétiques,
Gaïa s’était refroidie, devenant grise…puis orange : c’était la marque de
l’apparition de l’oxygène, de l’oxydation de l’atmosphère primitive, de la mise
en route de la pré-Vie, puis de la Vie elle-même : les monères d’origine
moururent, incapables de synthétiser ce poison oxydant, cédant la place à des
micro-organisme dotés de la capacité de photosynthèse : les
cyanobactéries, mot inusité en 1800.
Mais il leur avait fallu l’eau pour s’engendrer,
pour se développer, pour gagner : Gaïa la bleue était née après qu’une eau
diluviale se fut déversée sur notre planète, donnant naissance à une Pan
Thalassa. Aucune terre, aucun continent, n’avait encore émergé. Du côté
embryonnaire s’étaient succédé la morula, boule indifférenciée de cellules (stade
de Gaïa grise), puis la blastula invaginée (Gaïa orange), ensuite la
réorganisation générale des trois feuillets embryonnaires, partage des couches
de tissus et prélude à l’organogenèse : la gastrulation coïncidait avec
Gaïa bleue. Dans leur naïveté, Thomas Burnet, Pierre-Simon de Laplace mais
aussi Georges Cuvier assimilaient à tort cette planète bleue à celle du Déluge
universel, événement mentionné dans maintes cultures et civilisations.
C’était oublier que Thomas Burnet était
théologien. Le frontispice de la Telluris
Theoria Sacra représentait sept sphères. L’ambiguïté du dessin suggérait
qu’on pût le lire dans les deux sens, puisque ces Terres constituaient un
cercle rotatif : soit dans le sens des aiguilles d’une montre, soit par
une rétroversion. Cependant, Gaïa verte ne constituait que la sixième des
sphères, celle supposée présente, avec ses continents, ses mers, ses montagnes,
ses fleuves et ses forêts. Nulle théorie des Pangées successives en cela !
Gaïa verte coïncidait avec la neurula embryonnaire. Mais, rappelons-le, il existait
une sphère ultime, la septième du système britannique : Gaïa jaune. Si l’on optait pour une
lecture du frontispice dans le sens de rotation des aiguilles, l’on aboutissait
à la Terre métamorphosée en soleil ardent, sorte de nova improbable. C’était
là le devenir, un devenir de feu rénové, et la Gaïa asiatique pouvait au
contraire signifier, en tant que première sphère, le commencement solaire,
source de vie, alors qu’une lecture étroite de Burnet voudrait dire son inversion
morbide : un astre stérilisé par le feu ardent, jaune comme le désert, où
aurait disparu toute vie, où l’eau se serait évaporée. Gaïa jaune, du point de
vue oriental, symbolisait l’or, la brillance, la pureté, le Nirvana bouddhique,
la Paix préludant à la réincarnation après les quarante-neuf jours d’errance au
Bardo. Mais aussi, ce qui dépassait les connaissances acquises en 1800, le
renouvellement cyclique du monde, le nouveau départ du nouveau Big Bang. La
roue des sphères tournerait, en une rotation sans cesse recommencée, de réincarnation
en réincarnation, de cycle en cycle, jusqu’à l’achèvement. Rien de tout cela en
Occident, hélas !
C’était pour le théologien britannique un
avenir d’Apocalypse, de fin de toute chose, de parousie, en correspondance avec
le passage de l’embryon au fœtus, menant au terme de la gestation, à la
naissance de l’Homme. Pour le malheur de la planète, malgré le sacrifice du
Christ, sa résurrection et la fondation de la Nouvelle Alliance ? Etait-ce
oublier qu’en son inversion du cours, la Gaïa des Tibétains s’achevait par le
commencement, par la Terre noire ? Etait-ce là un néant, ou une fin
provisoire que la conception cyclique sauvait, car tout était par essence voué
à l’éternel retour, au recommencement ? Si en Occident, noir préludait à
jaune, un jaune terminal, en Asie, jaune préludait à noir, un noir qui n’était
pas Mort mais Renaissance. Conjecture ! Eschatologie contradictoire !
En clair, sans qu’il l’admît, Pierre-Simon
de Laplace venait de révéler de manière plus ésotérique que scientifique la clef
de la fin des temps : l’Homme, à
terme, porterait et assumerait le lourd fardeau de la responsabilité de la fin
du monde…
A ces spéculations polluant sa pensée, le
scientifique frémit ; il prit la décision d’édulcorer son rapport, d’en
présenter au despote une version tronquée et plus simple.
Mais il avait oublié un élément primordial :
celui où deux stades coïncidaient dans les séries tibétaine et occidentale.
Noir-jaune, rouge-vert, gris-bleu,
orange-orange, bleu-gris, vert-rouge, jaune-noir… Le télescopage de deux teintes
chaudes, les orange, avec l’étape du blastocyste, formait la véritable
résolution de l’énigme, qui permettrait peut-être d’atteindre la chambre
mortuaire de Langdarma.
A suivre...