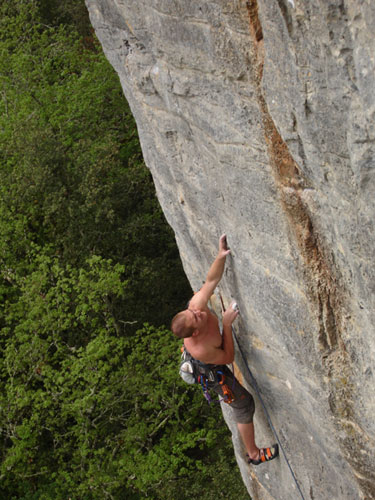Café
littéraire : Daddy Love, de Joyce
Carol Oates.
Par Christian Jannone.

On ne présente plus Joyce
Carol Oates, autrice prolifique, brassant et croisant plusieurs genres avec
maestria. Elle excelle autant dans la nouvelle que dans le roman, court comme
long, dans la poésie, l’essai et le théâtre. Ni le roman social, ni le réalisme
magique, ni le gothique, le roman noir ou encore le polar (sous les pseudonymes
de Rosamond Smith et Lauren Kelly), ne lui sont étrangers, tout comme l’autobiographie
lorsqu’elle nous parle du deuil, de la perte de ses conjoints. Inspirée depuis
soixante ans, sa plume refuse d’écrire le mot de la fin.
Joyce Carol Oates est à
la fois le témoin et la mauvaise conscience de l’Amérique contemporaine, et son
écriture alerte brasse toute l’histoire moderne des Etats-Unis, de l’orée du
XXe siècle jusqu’à nos jours. J’aurais envie de pasticher à son propos la
célèbre phrase du dramaturge romain Terence dans Le Bourreau de soi-même :
« Je suis une humaine, et rien de ce qui est humain ne m’est
étranger. » Cela lui convient à merveille.
En clinicien, elle
fouille les tréfonds de la psychologie, n’hésitant pas à mettre en avant
l’ambiguïté, l’ambivalence de ses personnages, nous rappelant à nous qui sommes
trop souvent tentés par le manichéisme (péché de notre époque), que nul n’est
tout blanc ou tout noir.
Joyce Carol Oates est née
le 16 juin 1938 à Lockport dans l’état de New York. Intéressée très tôt par la
lecture, elle dévore les œuvres des grands auteurs et autrices comme Faulkner,

Hemingway, les sœurs Brontë ou Dostoïevski. Elle se lance dans l’écriture dès
l’âge de 14 ans. Alors qu’elle étudie à l’université de Syracuse, elle tente
d’écrire ses premiers romans, sans qu’aucun ne la satisfasse. Ayant obtenu sa
maîtrise de lettres à l’université du Wisconsin à Madison, mariée à Raymond J.
Smith, elle s’installe à Detroit, ville bien connue pour ses tensions raciales.
« Detroit, mon grand
sujet, a fait de moi la personne que je suis, et en conséquence l'écrivain que
je suis, pour le meilleur et pour le pire. » a-t-elle dit.
Sa carrière universitaire
ne fut pas négligeable. Joyce Carol Oates enseigna à Beaumont, au Texas, puis à
l’université de Windsor en Ontario et enfin à Princeton, dans le New Jersey
jusqu’en 2014. En 1963, son premier
recueil de nouvelles paraît chez Vanguard, By the North Gate. Son
premier chef-d’œuvre, Eux, dont Detroit sert de cadre, est couronné en
1969 du National Book Award. Dès lors, sa production littéraire est
riche et prolifique, sans nulle panne d’inspiration.
L’abondance de son œuvre ne
signifie aucunement une baisse de qualité. Joyce Carol Oates acquiert une
notoriété internationale, et des romans comme Blonde (2000), inspiré de
la vie de Marilyn Monroe,

sont des succès mondiaux. De même, Les Chutes, livre
autour du suicide et du veuvage, paru en 2004 aux Etats-Unis, est
récompensé du prix Femina étranger l’année suivante. Veuve elle-même deux fois,
de Raymond J. Smith en 2008 puis de Charlie Gross en 2019, l’agonie de l’être
cher et le deuil lui inspirent une de ses dernières parutions, Respire, paru l’an passé en français.
Daddy Love est
sorti en 2013 aux Etats-Unis et en 2016 en France. Le roman comprend trois
parties, de longueurs inégales. Il suit un plan chronologique, d’une linéarité
apparente, mais la structure narrative s’avère géographiquement éclatée entre
le Michigan (Ypsilanti et à la fin Ann Arbor), que je qualifierais d’espace des
parents de Robbie Whitcomb, et Kittatinny Falls,

dans le New Jersey, espace de
vie de Daddy Love alias Chet Cash, de fait pasteur et prédicateur itinérant. Il
s’agit des espaces les plus familiers de l’autrice, de son vécu, embrassant les
Grands Lacs et la Nouvelle Angleterre. Cependant, l’action, étalée sur six
années (plus exactement entre le 6 avril 2006, jour de l’enlèvement de Robbie
et événement fondateur et tragique de l’histoire narrée et le mois de septembre
2012), privilégie les lieux périphériques, suburbains, aux grandes
agglomérations, l’habitat dispersé aux concentrations humaines les plus
imposantes.
Comme toujours, Joyce
Carol Oates fait preuve d’une précision, d’une rigueur historique, géographique
et sociologique dans lesquelles elle entrechoque et entrecroise le réalisme et
l’irrationalité. Je ne parlerai pas ici de réalité magique, à la manière de la
littérature latino-américaine ou de l’œuvre d’un Ondjaki en Angola. Disons que
nous sommes à la croisée des genres, comme souvent chez elle.
Ainsi, les quatre
premiers chapitres de la première partie, narrant l’enlèvement de Robbie dans
le parking d’un centre commercial d’Ypsilanti

digne de ceux existant en France,
à la vastitude conséquente et reflet de la civilisation du « tout
automobile », adoptent le principe de la répétition, de l’étalement
temporel, du piétinement « sur place » d’une action tragique, comme
s’il s’agissait soit d’une étude sur la décomposition du mouvement des prémices
du cinéma (chronophotographies de Muybridge et Marey), soit d’une boucle
temporelle revenant sans cesse tout en se complétant dans ses divergences,
jusqu’à ce qu’enfin, le chapitre 5 la referme et parte de l’avant dans
l’intrigue avec le hiatus et l’ellipse post-traumatiques de la mère. Style
superbe, étonnant, peu pratiqué en dehors de la science-fiction, surtout
d’ailleurs au cinéma, avec son prototype Un
jour sans fin. C’est là l’art de sublimer la banalité du fait divers
atroce.
Ce n’est pas la première
fois que notre autrice aborde le thème de la pédocriminalité, même si le mot n’est
jamais écrit ni prononcé dans Daddy Love.
Il figurait déjà dans Sexy (2005),
qui appartient à la littérature d’enfance et de jeunesse et dans Le Mystérieux Mister Kidder (2010),
novella mettant en scène un vieil homme distingué s’entichant d’une Lolita de
16 ans.
Avec Daddy Love, surnom
qu’il impose à se proies, nous avons affaire au prédateur, qui se double d’un
tueur en série. Chet Cash, pasteur itinérant – qui prêche pour une assistance
afro-américaine bien que blanc ! – enlève les garçonnets, qu’il transforme
en esclaves sexuels, maltraite, châtie, et emploie à la fabrication d’objets en
macramé qu’il revend. Il se débarrasse de ses victimes lorsqu’elles approchent
de la puberté. Il prive les enfants de leur vrai nom, comme de leur liberté,
leur attribuant une nouvelle identité : ainsi, Robbie devient Gideon.
La figure du pasteur
inquiétant se retrouve chez Flannery O’Connor,

figure majeure de la littérature
sudiste du XXe siècle dont notre écrivaine se revendique, dans La Sagesse dans le sang (1952), roman à
la fois gothique et grotesque, avec d’une part la figure du grand-père du
personnage principal, Hazel Motes, pasteur évangélique, et d’autre part celle
du prédicateur aveugle, que Motes, qui lui-même usurpe l’identité d’un
clergyman protestant, suit avec sa fille avant de fonder sa propre communauté,
dite « L’Eglise sans Christ ». John Huston adapta ce roman, apprécié
sur le tard, en 1979 (Le Malin).
Comment ne pas évoquer aussi La Nuit du
Chasseur (1955), unique film de Charles Laughton en tant que réalisateur,
chef-d’œuvre absolu dans lequel Robert Mitchum, prêcheur assassin et voleur,
n’a cessé de hanter notre mémoire cinéphile ?

Forte de cet héritage, de
ces références, Joyce Carol Oates ose mettre en scène un pédophile protestant,
alors que ne cesse de se développer la crise de l’Eglise catholique autour de
la pédocriminalité du clergé, en particulier aux Etats-Unis et en Europe, ceci
expliquant partiellement les échos critiques timides que le roman suscita à sa
sortie en langue française.
On peut parler de plongée
dans l’horreur, dans un aller-retour entre le duo Chet Cash-Robbie
« Gideon » et le couple Whitcomb (la mère Dinah, meurtrie dans sa
chair même, accidentée et défigurée par la voiture du ravisseur, et le père
Whit). La chevelure de Robbie questionne Chet Cash qui émet l’hypothèse d’un
enfant métissé, avec le même questionnement autour de Whit lui-même (p. 40).
De même, Joyce Carol
Oates se penche sur le passé de Chet, sur ses propres changements de nom, sur
la construction même de ce passé par le personnage, sur ses précédentes
victimes et ses relations avec autrui : la fable, le mensonge, s’entremêlent
avec le réel. En l’Eglise de l’Espoir éternel, il est Chester Cash, émissaire
du monde blanc, qui, auprès du
révérend Tindall, brode autour de son passé, y inclut tout un tissu de
références majeures pour la communauté afro-américaine : Martin Luther
King, W.E.B. DuBois,

sa naissance en juillet 1967 lors des troubles raciaux de
Detroit… Avant, il fut un délinquant mineur, déjà coupable d’homicide, Chester
Czechi, qui étrangla son cousin sans marquer de remords, incarcéré à neuf ans,
sorti à vingt-et-un du centre de détention du comté de Wayne (p.72). La folie
religieuse, justificatrice, légitime ses crimes sexuels.
Il y a cette croix de
bois surmontant sa voiture, véritable cercueil, instrument de torture,
dissimulation des victimes comme Robbie, qui peut rappeler ces emblèmes
publicitaires qui ornaient les véhicules de manière « monumentale »,
tels qu’on pouvait les voir en la caravane du tour de France, mais aussi évocatrice
de ces vierges de fer inquisitoriales, touche gothique d’effroi supplémentaire.
L’enfant y est caché, puni, s’y souille.
Il y a aussi ces rapports
de Chet avec les femmes. On apprend qu’il fut brièvement marié à une veuve bien
plus âgée que lui, Mme Myrna Helmerich, morte en 1999, dont il hérita de la
ferme de Saw Mill Road, là où il demeure et détient sa victime. Darlene
Barnhauser, 35 ans, du village de Kittatiny Falls, lui fait le ménage (portrait
saisissant du personnage p.88). Chet fustige Dinah, la mère de Robbie, pour lui
une pècheresse s’adonnant à la tabagie, manière de justifier son acte : de
la mauvaise mère, Robbie se retrouve aux mains du nouveau « père ». Le
vrai père, Whit, est un homme de radio, animant une émission culturelle à 23
heures, Classiques et New Age américains, sur WCYS-FM, sauf le dimanche.
Dinah, la mère, occupait
un emploi à temps partiel dans la bibliothèque de biologie de l’université du
Michigan, mais, suite à l’accident provoqué par Chet, elle a dû démissionner.
C’est le long travail
post-traumatique du couple que développe Joyce Carol Oates, travail que l’on
peut retrouver en maintes familles confrontées à une disparition d’enfant. S’ajoute
ici le sentiment de culpabilité de Dinah, allié à la blessure de sa chair, à la
rééducation, aux séquelles physiques et psychologiques. Sa mère elle-même lui
est hostile, renforçant ce sentiment de responsabilité. L’emprise des préjugés
de l’Amérique religieuse se fait plus prégnante encore : l’idée de faute
(avoir couché avec Whit avant le mariage), et l’amour éprouvé pour un homme ne
correspondant pas aux critères raciaux des WASP (White Anglo-saxon
Protestants).
Cependant, il y a
toujours l’espoir que l’on retrouve Robbie, que l’on punisse le ravisseur,
espoir qui certes ne peut que se réduire au fil du temps, résumé par la phrase
magnifique de la page 93 : « Ils attendaient. Chaque heure, chaque
jour, ils attendaient. » Cet espoir chevillé au corps que l’on retrouve
Robbie vivant, avec cet appel téléphonique salvateur qui ne vient pas,
sachant que plus le temps passe, plus la chance diminue. Après la
médicalisation de Dinah, son nouvel univers, la conviction inébranlable que
Robbie reviendra, suit l’ellipse de six ans. Des suites du malaise de Dinah
concluant les événements de 2006, nous ne saurons rien.
En parallèle, le temps
approche où Chet éliminera « Gideon », et après l’obéissance au
bourreau, pointe le stade de la rébellion. A la soumission, à l’esclavage, à la
fiction paternelle et scolaire, aux mensonges de Daddy Love succèdent
différents épisodes témoignant que « Gideon » échappe à son tortionnaire.
Ce que l’on appelle le syndrome de Stockholm cesse d’avoir prise sur lui aux
prémices de la puberté et de l’adolescence.
D’abord, la parenthèse du
chien. Certes, « Gideon » a été remarqué par Madame Swale,
l’institutrice de l’école de Lenape, où il est scolarisé en classe de CM 2,
certes, il a des amis « secrets », quelques camarades partageant sa
« timidité » et il s’est fait remarquer par ses dessins déroutants,
témoignant de son vécu, tels ceux des enfants victimes d’inceste et de viol
utilisés par la police et par les psychologues. « Gideon » passe pour
un enfant handicapé, une espèce d’autiste, de « muet ». L’enseignante
dresse de lui un portrait psychologique imparfait, ne soupçonnant rien du
drame, concluant à la blessure de la mort de la mère, fable véhiculée par Daddy
Love. Cet enfant intelligent, blessé, ne peut que se réjouir à l’arrivée de la
chienne Missy – bonheur éphémère, brisé par Chet Cash qui l’abattit de deux
balles de carabine, parce que « chien », comme il la qualifiait avec
mépris, lui était préférée par l’enfant qu’elle reconnaissait comme son maître,
la main nourricière, qu’elle se devait de protéger.

Après survient l’action
« criminelle » marquant le commencement de la révolte :
« Gideon » se fait incendiaire, « terroriste », brûleur de
trois garages, fabricant d’une bombe artisanale. Il y a dissociation croissante
entre l’enfant agile de onze ans et l’ancien enfant soumis, « Fils »,
comme le qualifie Daddy Love qui ne soupçonne rien de l’évolution sourde de sa
« créature ». Chet n’a pas su percevoir le mûrissement
de son cerveau sous l’enveloppe de l’enfant de dix-onze ans. Joyce Carol Oates
télescope à cette occasion le présent de 2012 et le passé des six ans de
Robbie, aux premiers mois de sa captivité, entremêlant souvenirs de 2006 et
passage à l’acte criminel de l’enfant révolté manipulant l’essence, s’en
prenant au garage de Mme Swale.

Fort de cet acte impuni – l’enquête de la
police n’aboutira pas – et cependant regrettant que cela n’eût pas attiré
l’attention salvatrice des forces de l’ordre sur lui et son prétendu père,
« Gideon », qui considère les enquêteurs comme des crétins (p. 205), voit arriver le jour
fatidique où Daddy Love doit se débarrasser de lui. La prétendue chasse au
trésor, à compter de la p. 221, sera celle de la fuite et du salut. Jamais Chet
Cash ne s’est douté que son « fils » était l’incendiaire, et qu’il
projetait de faire exploser une bombe (l’école premier choix non concrétisé, et
finalement l’usine), après s’être fait la main avec les garages. L’échec de la
bouteille explosive qui n’a pas fonctionné avec en sus l’oubli des gants qu’il
aurait dû voler à Daddy Love, a dépité Robbie, plus que jamais dissocié de
l’enfant soumis à son bourreau. P. 221-24, ce sera la fuite, la course pour la
vie avant le crime de Daddy Love. L’un des passages les plus caustiques, à mon
sens, est celui où Chet affronte un autre pervers sexuel qui convoitait Robbie
(p. 180-183). L’homme, fait cocasse, donne de l’argent à Daddy Love avant de
s’en aller, boitant, souvenir de Robbie survenu alors qu’il pensait à l’enquête
sur les incendies et se refusait à regarder son « père » dans ses
fonctions de Prédicateur à l’Eglise de l’Espoir éternel.
L’on verra dans les
ultimes chapitres les retrouvailles avec la mère Dinah, avec le père Whit, les
circonstances qui permirent de récupérer Robbie, l’arrestation de Chester Cash,
le suivi psychologique de Robbie par le Dr Kozdoi, cet espoir que Chet Cash
expie avant son procès, en étant tué par ses codétenus (cela est chose courante
pour les pédocriminels, c’est ce qu’on peut appeler la justice des prisonniers).
Enfin, ce finale p. 278-79, où la mère redoute que la tragédie de l’enlèvement
recommence…

Christian Jannone.