Ne… me… quittez pas, non, je vous en
supplie, NE ME QUITTEZ PAS. Pas comme ça, pas aussi cruellement, non, ma femme
bien aimée, ma fille chérie. Pas comme ça, pas comme ça !

Elles
étaient mortes, horreur ! mortes
des atrocités de la guerre, mortes à cause des barbares en vareuse
réséda, les non-humains Feldgrau… Longtemps, trop longtemps, il
avait étreint ces corps ou ce qu’il en demeurait… formes immondes, infâmes,
recroquevillées, rétrécies par le feu, noires, noires ô combien, extirpées des
monceaux fumants de l’église du village, méconnaissables, inidentifiables,
informes, déshumanisées, pantins, pantins calcinés !
La
Terre mentait ! Le Maréchal les
avait tous trompés…
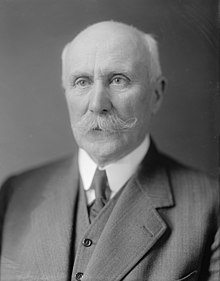
Il y avait cru, à ces verbiages vains, à cette idéologie
des menteurs… Toute la civilisation issue de la Terre cultivée l’avait
trompé ! Ce n’était qu’un vernis… Le Progrès n’était que fausseté,
tromperie, leurre, miroir aux alouettes du démon…
Il
avait longtemps réfléchi, recherché
les raisons, remonté les maillons innombrables de la chaîne des causalités
expliquant pourquoi l’humanité avait pu se rabaisser à des actes d’une telle
sauvagerie. Pourquoi sa famille avait péri, avait été massacrée ainsi, brûlée
vive, consumée en un holocauste, pourquoi lui avait été épargné,
opportunément absent des lieux de la tragédie, miraculé du hasard ( ?) ou
par la volonté d’une divinité immanente qui n’était pas le Dieu des
chrétiens qu’alors il renia.
Il
pleura des jours durant, se
terra, fuit ce monde, se réfugia dans un ailleurs où il rumina sa
vengeance. Le nazisme avait été engendré par la Civilisation ; il était
son aboutissement démentiel, l’aboutissement de la révolution technique, de la
pensée, de la philosophie, de la culture, l’industrialisation irréfléchie de la
Mort pour une cause dépassant tout, dévorant tout au nom des Idées, comme
Chronos.
Alors,
il sut. Il comprit le
pourquoi de toute chose. La Civilisation pervertie qu’il connaissait était née
de l’agriculture et le Maréchal avait commis un contresens, pensant que la
Terre qui ne mentait pas était celle des paysans. Faux ! Ce n’était pas celle-là,
celle que l’Homme avait soumise, mais une autre, antérieure, qui, au
contraire, domptait l’Homme qui dépendait d’Elle.
Il
avait été l’assistant d’un grand
savant, d’un abbé à l’éternel béret, un enseignant d’arcanes en une science
nouvelle s’intéressant à la vie des hommes fossiles, d’avant la soumission de
la Terre. Lui et les siens, à cause des événements, de cette guerre,
avaient cru trouver le havre protecteur, idoine, dans la France profonde rurale
de cette zone Sud où le Maréchal essayait de recoller les morceaux,
sans qu’il
se doutât de sa collaboration avec les barbares, de l’acceptation de leur ordre
nouveau, de sa traîtrise. Le long syllogisme qu’il avait patiemment
forgé, élaboré, avec des si, des donc, des c’est pourquoi aboutissait
à ceci :
La
Civilisation, c’est la barbarie. L’agriculture, c’est la barbarie, c’est
l’inégalité, c’est le crime sauvage. La Terre de l’Homme d’avant l’agriculture,
Elle, ne ment pas. Retournons en Elle, à Elle. Expiation !
**********
Lucille avait recouvré ses esprits après une
absence de quelques heures. Sans doute trop recrue, trop fourbue par les
épreuves qu’elle avait traversées, s’était-elle endormie du sommeil du juste.
Elle ressassait la témérité qui l’avait conduite à cette situation. Elle ne se
vanterait pas d’une telle aventure, parce que la fatuité, ce n’était pas son
truc.
La
fillette constata qu’elle se trouvait couchée, emmitouflée dans une sorte de
lit de fourrures, sans matelas. Elle n’était plus à l’air libre mais dans un
lieu clos difficile à déterminer, puisque la seule lueur qui y régnait
provenait de quelques lampes à huile en glaise cuite, d’un modelage grossier,
lampes qui fumaient et dégageaient une odeur âcre et rance. C’était comme si elle
se fût trouvée prisonnière dans une espèce d’igloo parmi des esquimaux féroces.
Ses yeux tentèrent d’appréhender plus en détail ce logis primitif. Elle
aperçut une voûte irrégulière, parsemée de concrétions blanchâtres qui
faisaient comme un semis de moisissures sur la garniture d’une de ces tartes,
spécialités du Canada, garniture que les naturels (si tant était-il que
les Amérindiens de là-bas acceptassent qu’on les désignât d’un terme un peu
raciste) appelaient ferlouche ou farlouche dont la recette consistait
en un mélange de raisins secs et de mélasse (la mélasse, c’est épais et
dégueulasse, trop sucré, se dit Lucille).
Elle
se rendit compte qu’elle était totalement nue sous la fourrure. Non, c’était un
comble ! Il l’avait déshabillée, le sans-gêne ! Elle était
pudique, et craignit le déshonneur, l’outrage fait à sa pudicité. Son visage
s’embrasa de honte.
Elle
entendit une voix émergeant d’une espèce de brouillard sonore. C’était lui. Qui
d’autre ? Elle marqua sa surprise. Ses yeux s’écarquillèrent. Lucille ne
s’était pas attendue à ce que son ravisseur parlât comme vous et moi, en un
français moderne. Il philosophait au lieu de lui demander si elle allait bien,
n’avait besoin de rien, si elle avait bien dormi, si elle avait faim ou soif.
« L’agriculture
est la racine du Mal », tel s’exprima l’être à l’adresse de sa petite
captive. Il apparut, s’approcha, épandant son musc sauvage. C’était un homme,
pas un cerf-garou ou toute autre chose de surnaturel. Il n’avait rien
d’exceptionnel, mais ne faisait guère preuve de prévenances à l’égard de sa
prisonnière, si ce n’était qu’il l’avait douillettement couchée et ôté ses
vêtements mouillés, qu’elle aperçut séchant, linge compris, près d’une espèce
de foyer grésillant et crépitant, où elle remarqua des coulées graisseuses,
témoignage qu’un gibier avait cuit là tantôt.
Elle
préféra ne pas tenir compte de ce qu’il disait et pria que ses parents lui
pardonnent son imprudence. Elle espéra le secours des gendarmes. Un prurit de
gêne occasionnait en elle des démangeaisons persistantes tandis qu’elle
adressait une prière muette aux siens :
Maman,
papa, pardonnez-moi ; Dominique, pardonne-moi ; Paul, pardonne-moi.
Priez tous pour moi, pour que rien ne m’arrive, pour qu’on me délivre. Sainte
Vierge Marie, venez-moi en aide. Je Vous adresse cette humble prière. J’ai
péché en n’écoutant pas les mises en garde du père Martin ; je n’en ai
fait qu’à ma tête de linotte. Pardon, pardon.
Que
ma captivité soit douce, se
surprit-elle à souhaiter, sur le ton de l’imploration, de la supplique. Après
tout, je vis une aventure magnifique, mieux que dans tous mes rêves, dans
toutes mes espérances, plus intense que dans tout ce brimborion de romans que
j’ai lus ! poursuivit sa pensée en des vagabondages que ses proches
eussent jugés dévergondés.

Outre la voix du ravisseur, son odeur
puissante, sa silhouette et le léger grésillement du foyer préhistorique assez
rudimentaire, qui nullement n’atténuait l’impression de fraîcheur et d’humidité
de cette grotte de rétention, Lucille perçut un crépitement lointain, atténué,
qui, par moments, devenait plus fort, tel un martellement. C’était la pluie,
dehors, qui tombait de nouveau, drue, sans qu’il fût possible d’évaluer si elle
était diurne ou nocturne. Elle n’avait plus sa montre bracelet (perdue ?
en panne ? avec ses affaires, à proximité des douces flammes ? elle
n’eût pu le dire avec précision). La figure noirâtre de l’homme, enfin visible
à ses prunelles s’accoutumant à la lueur rudimentaire flammée, maintenant qu’il
avait ôté son masque grotesque, continuait à lui faire peur, déformée qu’elle
était par la lueur mouvante de l’éclairage primitif et rougeoyant. Il y avait
toujours ces yeux braisés de possédé, ce regard difficile à soutenir tellement
il s’imprégnait de démence et de quelque chose de démoniaque. Lucille essaya de
le scruter, mais sa position, redressée sur sa litière, tout en retenant la
fourrure-couverture afin de cacher sa nudité au peut-être satyre, ne facilitait
pas ce genre d’investigation psychologique, et elle dut se contenter de
détailler ses vêtements. Il était entièrement revêtu d’habits de peaux cousus,
comme chez les Indiens ou les Esquimaux du Groenland et du Pôle Nord et, parce
qu’elle connaissait un peu les textes de Paul-Emile Victor, elle savait que
cela dénotait chez ce fou un isolement total de la civilisation, sans doute
volontaire. Cependant, ni le pantalon, ni l’espèce de vareuse ou de chemise, ni
les mocassins, n’étaient frangés comme les habits des trappeurs, des Sioux ou
des coureurs des bois. Ça lui sembla du daim, ou du cuir de cerf, de renne ou
de la peau de chamois. De toute manière, rien n’était du présent en cette
grotte, pas le moindre ustensile métallique qui eût témoigné que nous nous
trouvions en 1960.

Il
poursuivait, imperturbable, voulant assener la leçon à celle qu’il pensait
désormais docile, prête à l’écoute :
« La
communion, l’osmose, la fusion avec la Nature, c’est ça l’important. »
Depuis
le temps qu’il devait vivre ainsi, ce mode d’existence avait dû lui taper sur
le système. Pourtant, il s’enquit du linge de la petite captive, le toucha,
afin d’en vérifier le niveau de séchage.
« Tu
peux te rhabiller, c’est sec.
-
Devant vous ? Il n’en est pas question ! »
C’était
la première fois qu’elle lui adressait réellement la parole. Elle se jugea
culottée de lui avoir répliqué. Mais elle put constater que les intentions
immédiates de l’homme-cerf n’étaient ni mauvaises, ni malfaisantes.
« Je
ne te regarderai pas, ajouta-t-il, j’irai me cacher derrière la peau tendue,
là-bas. » (Cette peau tannée l’était à la manière de celles des bisons
chez les Indiens.)
Elle
obtempéra. Elle crut l’entendre marmotter ma fille. Etrange. A ses
oreilles d’enfant, cette voix étrangère lui parvint altérée, quoique les
inflexions ne trahissent par elles-mêmes aucun accent, ni d’ici, ni d’ailleurs.
En fait, c’étaient des trémulations d’émotion, de trouble, qui déformaient la
parole du ravisseur. Ma fille… en avait-il une, en avait-il eu
une ? Peut-être était-elle morte ? Lucille se méjugeait, ne pouvait
calculer l’âge de cette face noire, rebelle à l’eau. Elle lui sembla labourée
par le temps, par les épreuves de la vie. Et s’il avait dit de cette voix à la
ténuité languissante ma fille parce que Lucille lui ressemblait, et que
c’était en fait pour cette raison qu’il ne l’avait pas tuée comme
Népomucène ou madame Consac ? Le regard farouche du fauve s’était à peine
modifié, mais dans le sens de l’adoucissement. Elle eut l’impression qu’il
pleurait. Ses sens, sa vue, son ouïe, ne la trompaient pas, bien que des larmes
ne parussent pas couler sur ses joues encrassées. S’il les avait versées
franchement… Non, ce chagrin à peine exprimé était sincère. Endurci par le
temps, il avait appris à retenir ses larmes. Elle ne le savait pas, ne voulait
pas savoir comment avait été cette fille, l’âge auquel elle était morte,
quand, dans quelles circonstances, elle l’était. Oui, c’était évident :
Lucille ressemblait à cette enfant perdue, tragiquement sans doute (de maladie,
d’accident ? à cause de la guerre ? puisque l’homme-cerf paraissait
assez âgé pour qu’il l’eût vécue). Morte depuis longtemps, dix, quinze, vingt
ans… Lucille telle qu’elle, telle ce qu’elle aurait donné (lui
seul connaissait l’âge de la défunte), plus tard, un peu plus grande, car
perdue à cinq ans, assassinée par le feu des barbares. Peut-être que
cette mort expliquait pourquoi il avait sauté le pas, commis ses crimes. En ce
cas, pourquoi aurait-il mis tant d’années à agir ?
Petite
robe courte à smocks de teinte vanille, chaussettes blanches, chaussures à
lanières, nattes châtain clair tressées, dorées, moirée aux rayons du soleil de
juin, ornées de rubans blancs, petit chapeau de paille, frimousse ronde et
franche tachetée de son, sourire, air rieur, joie de vivre de l’enfance. Main
tenue à maman. Nous étions un 10 juin, à l’approche de l’été, et ainsi Jeanne
s’était présentée à papa, le matin fatidique. La dernière fois, la toute
dernière fois qu’il l’avait vue vivante. Mignonne, ô mignonne. Pierre, ainsi se
nommait-il.

« Papa,
pourquoi tu viens pas avec nous ?
-
Je ne peux pas, mon amour. (il devait se rendre au village voisin de Javerdat
pour aller examiner des cailloux bizarres qu’un habitant disait avoir
découverts dans son champ, et l’homme, sachant Pierre spécialiste, pensait
qu’il pourrait lui dire s’il s’agissait de silex préhistoriques)
-
Allons, Jajanne (ainsi la surnommaient ses parents avec tendresse), mets ta
petite veste, avait dit la mère. Il fait encore frais le matin. Et n’oublie pas
d’embrasser papa très fort.
-
Oh oui, oh oui ! »
Elle
s’était jetée dans les bras de son père, toute petite, toute menue, en criant,
en riant, enthousiaste :
« Papa !
Mon papa !
-
Sois bien sage, ma Jajanne. »
Avant
qu’il s’éloignât avec son vélo, Clémence, l’épouse adorée, avait dit :
« Prends
garde mon Pierre chéri. On dit que les Allemands sont dans les parages. »
Désinvolte,
alors qu’il enfourchait sa bicyclette, il avait jeté à la cantonade :
« Ne
crains rien, je suis en règle ! »
Puis,
il était parti, sans appréhension.
(…)
Dans ses cauchemars récurrents, qui n’avaient
de cesse de se renouveler chaque nuit, en éternel retour, il étreignait encore
ces cadavres grotesques, presque carbonisés, étrécis, à la température encore
ardente, figés dans des postures invraisemblables, irréelles, comme statufiés,
pétrifiés de charbon. Et il criait, clamait sa vengeance inassouvie :
« Je
vous aurai tous, tous, vous qui avez fait ça, vous les responsables ! Je
vous enverrai flamber en enfer ! Et vous y resterez ! »

Voyant
qu’il s’était éloigné, Lucille se leva de la litière avec circonspection. Elle
drapa son intimité dans la chaude peau, aux poils doux au toucher. Elle
s’approcha, des sous-vêtements d’abord, jetant un coup d’œil discret de crainte
que la lubricité redoutée de l’homme-cerf l’épiât et attendît l’occasion
propice pour s’exprimer à son encontre. Elle enfila culotte blanche et
chemisette de dessous en coton et en flanelle, avec toujours un brin persistant
de prudence, d’hésitation, après avoir constaté au toucher qu’ils n’étaient
plus humides, que l’homme avait raison. Puis vint le tour des chaussettes. Elle
s’obligea à une posture assise, malaisée, à même le sol de terre battue, se
disant qu’elle salissait son arrière-train. Elle trouvait cependant indécent de
conserver aujourd’hui les mêmes dessous ; c’était contraire à l’hygiène, et ses parents lui avaient
enseigné, dès son plus jeune âge, qu’il fallait qu’elle les changeât
quotidiennement ; de plus, elle avait appris à en faire elle-même la
lessive, soignant son petit linge aux petits oignons, comme fascinée, coquette,
maniaque de sa propreté intime. Enfin, si une petite envie la prenait, où donc
ferait-elle ses besoins élémentaires ? Dans un trou ?
Elle
boutonna le chemisier à col Claudine délicatement brodé et broché bien qu’un
peu froissé, toujours en culotte, les mains légèrement moites, comme
excitée à la pensée qu’un jour,
peut-être, elle devrait faire ça devant celui avec lequel on la marierait,
s’exhiber ainsi, ravaler sa pudeur, ses préjugés de fillette…pour avoir un enfant.
Puis vinrent le pantalon d’équitation, le pull bleu pastel, enfin les bottes.
Voilà, elle était prête. Elle inspecta son duffel-coat, et dit :
« Vous
pouvez sortir, monsieur. »
Ce
monsieur l’embêta. Lucille demeurait bien élevée, quelles
qu’eussent été les circonstances.
Alors
qu’il s’extirpait de son « paravent » indien, elle ajouta.
« Auriez-vous
un miroir et un peigne ? Je dois me recoiffer. »
Un
de ses rubans veloutés s’était dénoué, et une couette pendouillait, lamentable,
lui chatouillant la joue droite.
« Tu
es jolie, fit-il. Jeanne… »
C’était le prénom de la morte à laquelle elle ressemblait ; elle le
comprit, renouvela sa demande.
« Je
n’ai qu’un peigne en os. Du temps de mes ancêtres, les glaces n’existaient
pas. »
Il
s’humanisait de plus en plus et elle craignit que cette intimité naissante
entre le ravisseur et la proie allât trop loin.
Elle
me supplie, elle m’appelle ! Elle veut exister, revivre, exister à
nouveau, toujours… Elle m’apparaît, implorante, chaque nuit. Jeanne !
Jeanne ! Ma fille adorée ! Tes
cheveux, tes yeux, ta gaieté, tes joies et tes chagrins d’enfant…Tes jolies
petites robes…et comme tu sentais bon ! Si proprette malgré les
restrictions. Encore, encore une fois, ma Jeanne, ris, souris, fais des
grisettes à papa !
Il était la désespérance incarnée… Plus de seize ans,
déjà ! Funeste, funeste 10 juin 1944 !
Lucille
se résignait à se coiffer avec ce moyen rudimentaire, ce peigne magdalénien
qu’il lui tendit. Les femmes préhistoriques, après tout, se dit-elle, étaient
déjà coquettes, loin de toute forfanterie exagérée de vamp de cinéma.
L’éternel féminin.
Son
coiffage achevé, elle se fit davantage audacieuse.
« J’ai
grand-faim, monsieur, s’il vous plaît. », osa-t-elle, presque malapprise
bien qu’elle conservât son langage posé. Son estomac grondant, criant famine,
témoignait que l’heure du petit déjeuner était passée depuis longtemps. Les
enfants, ça mange bien, pour la croissance, pour fortifier les os, et tout, et
tout. Item pour bien apprendre en classe ou, comme elle, avec la répétitrice.
« Je
n’ai que du gibier à vous offrir », fit-il, comme penaud.
Je
m’adapterai à son régime alimentaire, dussé-je en avoir la nausée, se résigna Lucille. Tout occupé désormais au bien-être
de sa captive, l’homme-cerf en avait oublié de déblatérer ses aphorismes sur la
Nature. La Belle et la Bête, songea Lucille, en un éclair de pensée
fugitive.
Ce
n’est pas sans déplaisir que la fillette aventurière jaugea l’espèce
d’infection qu’il proposa à sa bouche, chose qu’elle supposait être un reste de
cuissot de sanglier tout noir.
J’en
serai quitte pour une bonne diarrhée ; tant pis pour moi et ma témérité, médita-t-elle en mâchonnant la saloperie semi-putride.
Après tout, bien des bonshommes élevés à la dure, comme ces Robinson Crusoé
ou ces explorateurs du Pôle Nord ont été obligés de bouffer ce qu’ils
trouvaient à se mettre sous la dent, faute d’autre chose de plus approprié.
Elle
s’imaginait prisonnière pour longtemps, si longtemps que ses vêtements (elle
n’en avait aucun de rechange) finiraient par tomber en lambeaux. Afin de ne pas
vaquer toute nue en présence du geôlier, elle ferait comme lui, se vêtirait de
peaux préhistoriques, tandis que ses cheveux pousseraient tout fourchus et que
sa peau deviendrait toute noire de saleté.
Je
deviendrai une petite sauvageonne, un Mowgli femelle…Le plus difficile à
supporter, outre ce régime carné peu varié de primitif, ce sera le frottement
permanent des fourrures sur mes fesses, parce que je n’ai aucune autre culotte
à me mettre et que, quand celle-ci sera fichue…
Elle
interrompit le fil de sa pensée ; elle se rendait compte que la viande
qu’elle mâchouillait avec une expression dégoûtée convenait plus qu’elle n’eût
cru à son palais délicat de petite fille snob de riches, et qu’il valait mieux
cela que de se laisser mourir de faim. Elle avait failli se montrer
irréfléchie. A Rome, je ferais comme les Romains ; chez ce Cro-Magnon
attardé, je fais comme les hommes des cavernes. Pas comme bon me chante.
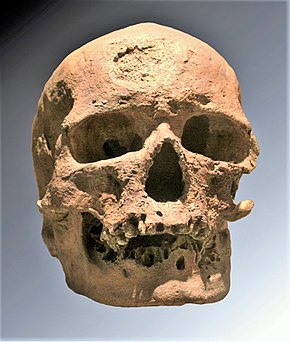
Alors
qu’elle achevait sa manducation, elle l’écouta parler. Il lui raconta
sa vie, par bribes douloureuses.
A suivre...
********

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire