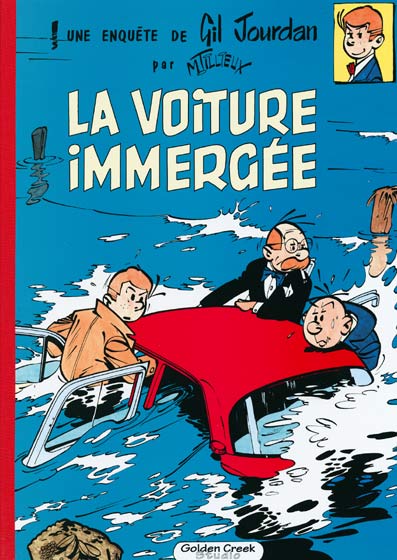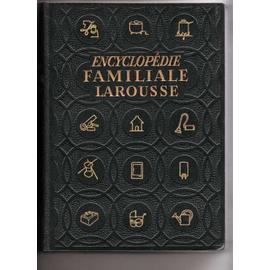La
ferme des Consac était sise à huit kilomètres du champ où l’on avait découvert
le premier mort. L’activité des travaux et des jours y ralentissait,
s’acheminait vers le repos de la morne saison. Avant que fût venu le moment de
la reviviscence de la nature, les Consac préparaient la terre et le bétail à la
stase hivernale. Après le temps de l’estivage était arrivé celui de
l’hivernage, de la stabulation. Habituée depuis sa plus tendre enfance au rude
labeur ancestral, Jeannine Consac s’était chargée du fourrage des bêtes, un
superbe troupeau de belles limousines à la robe couleur de froment. Ainsi,
assurées de leur provende, les vaches pourraient sans encombre supporter un
hiver qui s’annonçait tout aussi rude que de coutume. Madame Consac maniait la
fourche avec maestria. Elle assemblait les fenaisons sèches, pourvoyait les
mangeoires de l’aliment vital, veillait qu’en l’étable rustique, il ne fît
point trop froid.
Elle rentra le troupeau, respectant la hiérarchie sociale,
débutant par la reine, la jolie Julienne, prenant soin de celles dont le
veau était sous la mère, de celles qui allaient vêler tôt, finissant par les
génisses, clôturant par le bœuf, enfermant à part le taureau fécondateur, dans
une stalle conçue pour lui, jusqu’au réveil de la prochaine saison de la
saillie. Fourbue, sa tâche achevée, elle s’épongea, avant d’aller rejoindre
l’époux, le Jean-Paul, qui vérifiait la bonne tenue des semailles, là-bas. Elle
ne craignait pas de s’empoicrer toute. Son tablier à carreaux usagé, passé
par-dessus une méchante jupe et un chandail de laine d’un vert délavé, ses
jambes gainées de bas de laine, ses pieds encore chaussés d’antiques sabots
salis par la bouse dans laquelle ils pataugeaient sans cesse et sans façon,
bien qu’il lui arrivât de mettre aussi des bottes en caoutchouc, ses cheveux bruns
dissimulés par un foulard qui la vieillissait tout autant que les ardeurs du
soleil que sa peau subissait depuis qu’elle était née, Jeannine savait qu’elle
n’était pas belle, tavelée, ravinée avant l’heure. Elle avait quarante ans,
n’était jamais coquette. Elle se moquait bien du paraître, bon pour Madame la
baronne. Elle s’inquiétait aussi pour l’avenir de son fils de seize ans, Léon,
l’aîné, tenté par la ville, réticent à reprendre un jour l’exploitation. Trop
d’ardeur, trop de labeur, trop de responsabilités…

Le
soir approchait. Le soleil achevait son couchant, plus tôt, parce que c’était
l’automne et bientôt la Saint-Martin, temps des premières semailles, du repos
des terrains, d’avant germination. Puis, la glandée viendrait. On préparerait
tout cela, ces glands, et les châtaignes aussi, qu’on aurait ramassées à la
châtaigneraie proche. On préparerait des bouillies, des conserves, avec la mère
Muron, du village voisin. On récolterait truffes et champignons aussi. Enfin,
on égorgerait Zéphyrin, le cochon, son rôle terminé, son successeur encore dans
la matrice de la truie, pour le lard, pour la couenne savoureuse, pour la
soupe, pour enrichir l’ordinaire chiche, dépourvu des nouvelles denrées
superflues venues d’Outre-Atlantique, pour les longues veillées loin de toutes
ces stupidités de la ville, cinéma, radio ou télévision. On se replierait sur
soi, entre soi, jusqu’au prochain printemps. Le cycle se poursuivrait,
immuable, toujours recommencé, tant que le monde serait monde, tant que vivrait
la terre, tant que le grain existerait ; Jeannine en verrait bien encore
vingt, trente, de ces cycles. Elle s’éloigna de l’entrée de l’étable après
qu’elle en eut refermé les battants. Elle devait se hâter, avant qu’il fît trop
sombre, avant que s’aventurent dans les territoires de l’homme les créatures
sylvaines, renard, belette et sanglier en quête de bonne fortune, de
nourritures faciles. Poulailler et clapier étaient fermés en suffisance ;
le Jean-Paul venait d’en contrôler grillages, serrures et verrous.

Elle
remarqua un nuage d’étourneaux sansonnets dans le ciel grisâtre et bis comme un
vieux pain et ne s’en inquiéta nullement. C’était normal ; c’était la
saison. Il fallait bien que les oiseaux quêtassent leur abri pour la nuit, leur
arbre grégaire dont le dénuement des feuilles s’achevait presque à cette date
après qu’il eut été diapré d’écarlate ou de cuivre. Elle sentit un souffle
frais, plus proche de celui qu’aurait produit le déplacement d’un gros animal
que d’une quelconque brise du soir. Ses oreilles perçurent une espèce de
clapotement, en provenance du ru proche, comme si des pieds ou pattes s’étaient
aventurés à traverser ce ruisselet, ou à le dévaler depuis le coteau qui
surmontait le domaine. Elle entendit quelque chose d’autre ; ça lui rappela
le bramement du cerf. Le grand bois des Bonnemares était trop loin. Un cerf
n’avait pas pu aller jusqu’ici.
« Qui…qui
est là ? » se surprit-elle à prononcer.
Un
autre bruit, comme un piaillement isolé, solitaire, venu du même endroit, à
proximité du ru, retentit, mais ténu. Un sansonnet perdu ? Ça ressemblait
à une sorte d’appel du mâle à la femelle de l’oiseau, mais non point d’un
oisillon en détresse. L’époque des nidifuges et nidicoles s’était enfuie en
l’après beaux jours. La fermière scruta l’horizon, dans la direction de cette
présence inconnue. Il y avait des broussailles, par trop entremêlées pour
qu’elle distinguât grand-chose. Jean-Paul aurait dû débroussailler les abords
cet été ; il avait été négligent. Elle crut percevoir comme des andouillers,
mais point la tête du cerf. C’était une forme trop vague, trop imprécise.
Alors, le piaillement reprit, plus intense, pépiement auquel succédèrent une
sorte de croassement, puis un autre cri, d’un seul oiseau, qui rappelait
celui du vanneau ou du geai. Elle n’était ni ornithologue, ni chasseur. Pour
Jeannine Consac, les oiseaux n’étaient que picoreurs et chapardeurs de
graines ; des nuisibles, et rien d’autre. L’épouvantail les effraierait en
suffisance. Ce fut alors que le nuage d’étourneaux parut se mettre en mouvement
vers la source des bruits étranges. Il s’y attarda, attendant quelque chose.

Au-delà
d’où portait le regard de Jeannine, au Nord-Ouest, s’étendaient les restes de
l’ancienne peupleraie abandonnée, à deux kilomètres de l’étable.
L’arrière-grand-père de l’actuel baron avait tenté vers 1860 d’acclimater les
peupliers dans cette zone trop rude, suivant en cela la politique de
reboisement tous azimuts de Napoléon III. Un siècle après, un tiers seulement
des plants d’arbres avait survécu ; la plupart n’avaient pas résisté aux
hivers, d’autres avaient succombé à des parasitoses diverses, chancres,
champignons, tumeurs ou autres, ou du fait de l’intromission sournoise de
larves d’espèces d’insectes variées et friandes de bois dans les tissus
ligneux. Fragilisés, les derniers survivants épuisés ployaient à les rompre
leurs troncs élancés, presque écorcés et creux, bien peu majestueux, leur
feuillage noir fripé réduit avant terme. De là, de cette ruine sylvestre,
accourut une seconde volée, harde de corneilles croassantes, qui parut
rejoindre les étourneaux en un conciliabule planant à l’emplacement des
andouillers mystérieux. Puis, tout s’envola, en direction de l’étable.
Alors,
madame Consac prit peur. Elle courut, voulut s’en retourner, comme pour précéder
les oiseaux en leur course. Elle avait compris : elle devait protéger ses
bêtes. Ç’avait été d’abord une menace sourde, sournoise, latente, étale,
semblable à celle d’une eau qui dort ; puis, cette eau de marais s’était
réveillée, s’était muée en quelque tempétueux torrent dévastant tout, ravinant
tout, en crue imprévisible. Les oiseaux, en un bruit immense, témoignant de
leur nombre, attaquèrent le bâtiment. Apeurées, ressentant la menace dont elles
étaient l’objet, les limousines émirent force meuglements de détresse.
C’était
à croire que les becs de tous ces volatiles acharnés et haineux, devenus aussi
acérés, coupants et pénétrants qu’une lame affûtée et aiguisée, s’étaient vus
doter d’une faculté de perforation surnaturelle des murs de l’étable. Leur
quantité faisait leur force. Ils pénétraient le bois, rompaient les planches,
disloquaient les tenons, les éclisses, démantibulaient tout le bâti avec une
facilité déconcertante. Les assaillants entraient par les interstices ainsi
engendrés, élargissaient les brèches, se ruaient à toute volée afin d’attaquer
les bovins.
Les oiseaux étaient bien plusieurs centaines
et Jeannine put constater que le pullulement appelait le pullulement :
d’autres volées arrivaient des bois, des autres champs, appelées par leurs
congénères à participer à cet assaut inédit de mémoire d’être humain. Ces nuées
effectuaient leur fusion l’une après l’autre ; elles parurent bientôt
emplir toute la voûte céleste. Les cris, les battements de tous ces corvidés ou
étourneaux devenaient si intenses qu’ils retentissaient continûment, se
métamorphosaient en un crépitement sans trêve. Les plumages noirs ou mouchetés
semblaient luire d’une rosée argentée, comme irisés et diaprés de gouttelettes
de mercure. Les ailes diaboliques se comptèrent bientôt par milliers, arrivées
de toute la contrée, avides de participer à la curée générale.
Comment
protéger le bétail ? Comment contrer cette horde grouillante ?
Jeannine pensa au feu. Elle eut conscience d’affronter des nuées atteintes
d’instincts carnivores inédits, dévorateurs. Les vaches, dans l’étable
dévastée, étaient percées de coups de becs et leurs robes de froment se
tachetaient d’écarlate. Elles meuglaient de douleur, d’incompréhension, piquées
d’aiguillons multiples, percées, picorées par des prédateurs imprévisibles,
incroyables, qu’elles n’avaient jamais connus de mémoire de ruminants. C’était
une abomination, un hallali aviaire, le pire cauchemar qu’on pût imaginer. Jeannine s’enquit d’un luminaire ;
là-bas, la vieille lampe à pétrole. Elle ferait bien l’affaire. Il suffirait
d’allumer quelques monceaux de paille et les oiseaux, affolés, fuiraient…
« Mes
bêtes, mes pauv’bêtes ! Tenez bon ! J’vas vous tirer de
là ! » leur dit-elle avec une affliction navrée, comme si elles
avaient été dotées d’une conscience humaine. Par-devant l’étable en voie de
dévastation, à son porche, c’était un grouillement noir. Les diables volants
formaient comme un barrage. La lutte promettait d’être inexpiable entre cette
volée presque surnaturelle et la paysanne plongée dans cet enfer prometteur de
folie.
Elle
vida la lampe sur toute la paille qu’elle put trouver, qu’elle parvint à
tasser, à amonceler près du bâti bien que les corvidés l’assaillissent à son
tour ; mais, de ce liquide inflammable, il n’y en avait pas en suffisance.
Elle alla chercher un jerrican dans la remise qui servait de garage, remise où
était entreposée la motocyclette de l’époux. Il lui fallait aussi un briquet
pour l’ignition de tout cela. Jean-Paul, le Jean-Paul devait venir l’épauler.
Des frondaisons là-bas, d’autres nuées belliqueuses affluaient. Jeannine, avec
effroi, en vit certaines se diriger, sciemment, vers le champ où l’époux
inspectait les semailles. Désormais, tous étaient en danger. Alors, elle cria
au secours, voulant le prévenir un peu tard, espérant que sa voix porterait.
Dans le même temps, le briquet demeurant introuvable, elle ne put que se
résoudre à allumer le feu avec de simples allumettes. Les becs se faisaient
plus insistants que jamais, la tourmentaient. Ils piquaient ses cheveux, ses
mains, et la douleur fusait. Jeannine était en sang. Les monstres voulaient
qu’elle lâche sa boîte d’allumettes ; ils s’acharnaient, la lacéraient, la
griffaient de leurs serres. Elle titubait, renouvelait ses cris d’alarme. Pénétrer
en l’étable était devenu impossible ; en chasser les bêtes, proies de ces
horreurs aussi. Le barrage et le pullulement d’ailes tout autour du bâti
éventré par les becs était devenu tel qu’on n’en appréhendait même plus la
forme.
Elle
vit enfin une silhouette accourir, salvatrice. Reprenant courage, bien qu’on la
tourmentât, elle parvint à jeter une allumette enflammée dans la paille. Une
fumée s’éleva ; cela prit, timidement. Elle recommença, insistant, jetant
d’autres bâtonnets brûlants, déversant le mieux qu’elle pouvait le contenu du
jerrican afin que s’accélérât l’incendie. Ses blessures s’aggravaient. Les
oiseaux du démon visaient ses yeux.
Jeannine
aperçut le mari ; elle l’entendit crier : « J’arrive,
courage ! » tandis que les créatures aux ailes de suie, renouvelant
leur tactique, se divisaient en fronts multiples, multipliés avec constance, en
escadrilles létales, qui contre le troupeau, qui la piquant, crevant et
écorchant sa propre chair, qui assaillant et meurtrissant Jean-Paul.
« Oiseaux
de Satan ! Oiseaux de Satan ! » hurla-t-elle alors que des
filets de sang coulaient de sa chevelure défaite. La volonté des corvidés
n’était même plus de contrer l’homme ; elle était de tuer, de dévorer les
importuns étrangers à leur race volante. Le sang excitait leurs sens, leur
avidité. Aveuglée, ruisselante d’écarlate, Jeannine réalisa que, loin de
provoquer la panique des attaquants, le feu les encourageait, au contraire, à
aller jusqu’au bout. Le sinistre embrasa alors toute l’étable. Des vaches parvinrent
à s’échapper, d’autres se trouvèrent piégées. Les limousines en fuite,
meuglant, défonçaient ce qui restait des parois et des stalles. Elles
couraient, éperdues, suivies par des essaims croassant, la robe perforée,
cramoisie d’hémorragies, à demi dévorées. On entendait le martellement des
sabots, de celles qui fuyaient, de celles qui se trouvaient coincées dans le
brasier, l’expression vocale de leur détresse animale, l’effondrement des
poutres incandescentes s’écrasant sur les corps rongés de meurtrissures
becquées. On sentait l’odeur de la corne brûlant, du cuir et des chairs vives
s’enflammant. Du bâtiment ardent s’extirpaient les bruits des agonies bovines
dont certains finissaient par s’éteindre. L’une après l’autre, les limousines
succombaient dans la bataille.
« Jeannine !
Jeannine ! Miséricorde ! »

Elle
s’affaissa, énucléée, tombant, poisseuse de sang, dans l’incendie purificateur.
Les flammes œuvrèrent à sa dévoration. Il eût semblé à un observateur que
l’horizon, le ciel, indépendamment du crépuscule, rougeoyaient d’eux-mêmes du
liquide de la vie s’en allant, tachetés toutefois, maculés çà et là de brins,
de points fuligineux, cendrés ou noirs. Lueurs de l’incendie, embrasement
pourpré et rosâtre de la nuit approchant, jais et encre mouchetés des plumages,
particules voletant, virevoltant, de la consumation du bois, charbonneuses,
outrancières de par leur souillure retombant sur la terre. Fragrance immonde et
carnée, cornée aussi, évocatrice d’événements encore récents dans la mémoire
des hommes, de ces camps où l’ogre nazi exterminait, offrait à l’holocauste le
Peuple de l’Ancienne Alliance. Interdit séculaire de la crémation bravé ;
sacrifice antique des descendantes de l’aurochs. Sacrifice humain aussi.
Jeannine était morte, le troupeau de même, presque entier, Jean-Paul grièvement blessé. Léon Consac, ses
frères et sœurs absents, loin d’ici, aidant ailleurs, en ville, en village, en
d’autres métairies, avant le sommeil de l’hivernage, revenant à pied de l’école
aussi, comme autrefois, qu’il plût ou brumât. Aglaé Consac, dix ans, bras
dessus bras dessous avec son frère Marc, huit ans, cartable en bandoulière, de
retour de chez les Frères (six kilomètres à pieds !) découvrirent le
drame. Jean-Paul, le papa, gémissant dit : « Les gendarmes !
Avertissez les gendarmes ! »
A suivre...
A suivre...
*************