
Trois femmes superbes de la haute noblesse s'étaient donné rendez-vous en ce lieu où planait encore le souvenir du dernier des Condé. La ténébreuse affaire des fossés de Vincennes, crime politique insane commis par le général Buonaparte sur la personne du duc d'Enghien, avait privé comme on sait la lignée des Condé de toute descendance. L'extinction du lignage s'était accomplie par le biais d'une pendaison à l'espagnolette en l'an 1830, assimilée pour les uns à un suicide, pour les autres à un fâcheux accident aux sous-entendus paillards visant le bien connu phénomène physiologique de la virilité des pendus, puisqu'il existe une physiologie de la chose, comme il en est du mariage selon Honoré de Balzac et du goût d'après Brillat-Savarin.
Le dernier prince de Condé avait fait du château de Chantilly sa demeure, de retour d'émigration. Il la légua au duc d'Aumale, alors âgé de seulement huit ans. Le jeune fils de Louis-Philippe s'était tôt intéressé à la résidence et envisageait un réaménagement complet de celle-ci : ses appartements privés eurent Eugène Lami comme décorateur tandis que l'architecte Duban fut chargé de l'élévation d'une galerie de bois pour en assurer la desserte. Henri d'Orléans, duc d'Aumale, songeait déjà à reconstruire le grand château.
Pour les jardins, il n'eut guère à intervenir : le dernier des Condé s'en était jà occupé, à cause de la destruction de l'oeuvre de Le Nôtre sous la Révolution. En 1819, l'architecte Victor Dubois avait redessiné le jardin anglais sur ordre de feu Louis-Joseph de Condé. Parmi plusieurs aménagements romantiques, on remarquait un grand buffet d'eau et un temple de Vénus peuplés de cygnes et d'oiseaux aquatiques. Les recherches florales, botaniques, et les interventions es-horticulture avaient prodigué une touche savante à ces installations. L'orpin blanc ou trique-madame y fleurissait, de même la glycine et les cytises. Les tout neufs forsythias, inventés par le botaniste britannique Forsyth, puisque seulement répertoriés en 1839 par la classification linnéenne, y étaient remarquables. On y cultivait aussi les bouquets d'ombelles, selon un mode d' inflorescence savamment ordonné, entre autres ces bouquets de peucédans, qui inspireraient une poëtesse parnassienne de la fin de ce siècle, Aurore-Marie de Saint-Aubain :

Par l'ignifuge éclat de ton regard pythique,
Éblouit mon coeur d'or et d'électrum antique!
Volatile enjôleur, psittacidé, mon double!
Au symbolique hoir je dédie l'incunable,
La pogonotonie de ton être admirable! »
En quoi ces trois jeunes femmes méritaient-elles le qualificatif de superbes, comme cette galère du Roy Soleil, sujet d'un roman d'un futur écrivain du prochain siècle, membre de la RPR et attaché à l'histoire des galériens protestants, le sieur André Chamson? Commençons par la maîtresse de ces lieux, bien qu'elle fût la benjamine du trio : Madame Marie-Caroline Auguste de Bourbon-Salerne, princesse des Deux-Siciles et cousine germaine de son époux, duchesse d'Aumale depuis 1844. Winterhalter la portraitura pour le plus grand bonheur des amateurs de vraies beautés féminines. Cette blonde languide, aux longues boucles anglaises, à l'étisie aristocratique, au regard triste et doux, inspirait les artistes. Sa santé fragile était proverbiale.
Lorsque ses vapeurs la prenaient par surprise, madame la duchesse d'Aumale agitait avec frénésie une clochette d'étain, quémandant la salvatrice intervention de sa femme de charge, luttant ainsi pour que la pâmoison ne la prît point à l'improviste. La domestique accourait, se hâtait, apportant le providentiel émétique : ces fameuses pastilles d'ipéca, remède que la langoureuse blonde n'omettait jamais d'inscrire sur son livre de comptes de maîtresse de maison à la case : « frais médicaux en approvisionnement» avec la mention en encre rouge : « indispensable ». Que pouvait-elle donc trouver à ce vomitif d'apothicaire dans la tradition des Purgon, qui plus était amer comme chicotin? Cette racine avait été introduite dans la pharmacopée sous Louis XIV. Son nom complet, tel que monsieur Littré le rapporta ultérieurement dans son fameux dictionnaire, était ipécacuanha.
Marie-Caroline Auguste, née en 1822, n'avait pas le temps de s'intéresser à ces subtilités lexicales. Elle ne ressentait d'ailleurs aucune vocation littéraire, en cela qu'elle n'était pas bas-bleus.
Par contre, elle se passionnait pour la chose lyrique, pour l'opéra et l'opéra-comique, car les salles de spectacles chantés constituaient autant de lieux où il fallait être vu. Livret, intrigue, musique, orchestre, interprètes, étaient de peu d'importance, valant autant que pacotille, bimbeloterie, verroterie et autres brimborions. Cette simple amusette, ces divertissements, pas toujours dans l'acception pascalienne du terme, étaient souvent prétextes à l'étalage de virtuosité vocale pure, à morceaux de bravoure, au bel canto, surtout depuis qu'avait triomphé ce fameux style musical dit « Restauration », commencé et imposé avant même que Louis XVIII eût été intronisé. Les compositeurs transalpins y dominaient et excellaient en la matière. La scène s'illustrait depuis Napoléon Buonaparte par les ouvrages lyriques de Cherubini,

Rossini, Bellini, Paër

et Spontini. Les auteurs français n' acquéraient quelque notoriété que par la production d' une musique de plus en plus légère, pour ne pas écrire facile, délaissant, sauf monsieur Berlioz, toute ambition symphonique et concertiste et, à l'exception de monsieur Onslow, toute velléité chambriste. Quant au Conservatoire, il avait souffert des aléas politiques d'une manière plus civilisée que d'autres institutions : on y avait expérimenté le système du président des Etats-Unis Thomas Jefferson, institué en 1801, dit « spoil system », qui consistait à limoger ceux qui ne plaisaient plus au gouvernement ou avaient par trop soutenu le précédent régime, pour les remplacer par des hommes plus sûrs. Ainsi, Luigi Cherubini avait succédé à Bernard Sarrette, le fondateur du Conservatoire, révoqué deux fois, à la direction de celui-ci, après l'intermède de François-Louis Perne de 1816 à 1822, mais il avait fallu attendre sa mort en 1842 pour qu' Auber héritât du poste directorial. Même méthode à l' Université : au décès du grand maître Louis de Fontanes, placé par Buonaparte, le gouvernement royal avait nommé Denis de Frayssinous.
L' Institut, quant à lui, fonctionnait par cooptation, mais les choix n'étaient pas toujours heureux : ainsi, monsieur Onslow

y avait été préféré à monsieur Berlioz au fauteuil du défunt Cherubini. Onslow, cet Anglo-auvergnat dont le père, disait-on, s'était exilé en France à cause d'une affaire de moeurs. Onslow, un des rares compositeurs, écrivions-nous, à oser la musique de chambre, quand tout un chacun s'attelait à l'opéra-comique ou au grand opéra, comme en témoignaient avec constance les ouvrages de messieurs Hérold (†), Clapisson,

Auber, Halévy, Meyerbeer ou Adam...
La pratique du limogeage, cependant, valait mieux que la guillotine montagnarde ou la guillotine sèche des Thermidoriens et autres Directeurs, sans oublier la Terreur blanche et le peloton d'exécution du maréchal Ney, prince de la Moskova et duc d'Elchingen. Pourtant, elle avait fort marri monsieur de Chateaubriand, congédié comme un laquais après l'élection de la Chambre retrouvée de 1824.
Lorsque le vomitif américain avait prodigué ses effets purgatifs qui permettaient de préserver l'aristocratique maigreur de Madame, Marie-Caroline Auguste, duchesse d'Aumale, s'enveloppait frileusement d'un shal de cachemire et se retirait en sa thébaïde, c'est-à-dire son cabinet privé. Le quinquina et le cachou, autres médications souveraines, s'y substituaient alors à l'ipéca.
Cela, lorsque Madame était en relative forme. Car il n'était point rare que les domestiques la remarquassent, errant mélancoliquement en ses appartements, hâve, languide et pourpre, encore vêtue sur le coup des midi d'une méchante chemise de nuit de popeline azur ou guède, sous une robe de chambre de serge jaunette laissée ouverte, qu'il y ait frimas ou pas, les pieds nus bleuis de froid dans des mules grèges ordinaires non-fourrées, les mains fines et diaphanes protégées par des mitaines de filoselle, ses merveilleux cheveux blonds défaits, fols, entremêlés et tombant jusqu'aux reins, grelottant et toussant, l'iris bleu fiévreux et cerné. Elle s'asseyait au clavier du demi-queue et tentait de pianoter quelques fragments de valses de monsieur Chopin, la larme à l'oeil.
Comme toute grande demeure de ce temps, Chantilly était particulièrement mal chauffé et les vastes pièces n'arrangeaient rien. On avait beau jeter force bûches dans les cheminées, qu'elles tirassent bien ou mal, tisonner à tout-va, s'assurer de la solidité des chenets et de la hotte, le constat demeurait inchangé : Chantilly, comme Versailles et tous ces châteaux du Siècle de Louis XIV, n'était qu'une infâme glacière! Il n'était plus temps de savoir s'il fallait recourir au petit ramoneur savoyard, non point qu'il en manquât dans le secteur, mais parce que, servant un prince royal, celui-ci exigerait qu'on le payât conséquemment en bons jaunets et non en simples billons divisionnaires ; et le sang-bleu pouvait faire preuve de pingrerie!
Quand elle avait franchement grand froid, n'y tenant mais, Marie-Caroline s' emmitouflait dans une vieille pelisse, une de ces antiques peaux de carriole, droit importée du Canada, dont on eût voulu faire accroire qu'il s'agissait de caribou, alors que c'était simplement du castor.

Le commerce des fourrures était florissant chez les trappeurs et les coureurs de bois, crasseux comme pemmican corrompu, qui, rapportant leurs impedimenta débordant de peaux de la baie James jusqu'à Chicoutimi, voire plus loin encore, négociaient le tout auprès d'experts es-peausseries. Le tannage de ces fourrures, du pays du même nom, n'était point toujours parfait, loin s'en fallait, et le supposé caribou avait parfois de ces relents de pestilence qui témoignaient du mauvais savoir-faire des tanneurs et peaussiers. Heureusement, cela n'était pas le cas de la peau de carriole de Madame!
Elle trompait son ennui, en la fréquente absence de l'époux tout à ses campagnes militaires algériennes, en son cabinet privé, comme nous le disions tout-à-l'heure, par la consultation et la contemplation de ses collections de dessins et gravures. Non pas que cela fût un lieu à s' émerillonner, mais la pièce renfermait d'authentiques trésors. Le rituel débutait immanquablement par la succion d'une pastille de cachou qui produisait sur la duchesse l'effet du bétel des poëtes. Puis, Marie-Caroline garnissait un vase mille-fleurs chinois remontant à Kien Long d'un bouquet de renoncules, de clématites et de monnaies-du-pape agrémenté de rameaux de cyprès, conifère choisi pour sa qualité sempervirente, que ses jardiniers s'en allaient quérir en la cyprière proche. Elle renouvelait l'eau du vase, étape indispensable du rituel que l'on eût apparentée aux antiques libations ou lustrations, en cela que le geste gracieux de la Dame rappelait l'épandage et l'aspersion d'eau lustrale par les anciens prêtres païens. Il ne manquait à ce rite claustral à prétention propitiatoire que les palmes et le sistre, encore eût-il fallu que Marie-Caroline usât aussi de la situle, de la kylix

ou l'aryballe, que cette propitiation trouvât son accomplissement par la lustration supplémentaire de parfums, la consomption de l'encens en des cassolettes de cuivre, et, pourquoi pas, par le sacrifice d'animaux, porc, bélier et taureau, espèce d'holocauste à la romaine avec consommation des viandes, que les historiens passionnés d'antiquité comme ultérieurement Fustel de Coulanges nommaient suovetaurilia

quoique l'égorgement mytriaque du taureau fût également pratiqué dans l'Empire. Madame était peut-être en quête d'immortalité. Enfin, elle consultait sa collection en soupirant.
Marie-Caroline avait la daguerréotypie en exécration, que dis-je, en abhorration, non pas qu'elle préférât l'héliographie ou le physautotype de feu monsieur Niépce. Mais elle reprochait au système de ne pas reproduire les couleurs, de ne pas rendre suffisamment son incarnat rosé et diaphane de blonde névrasthénique. Ses beaux yeux langoureux admiraient de longues heures durant sanguines, aquarelles, estampes,

lithographies,
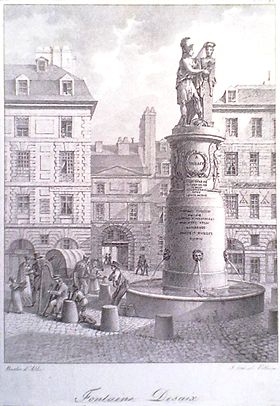
eaux-fortes,

aquatintes, tailles-douces...

Elle possédait une collection conséquente de gravures de Piranèse,

mais aussi de Rembrandt et Dürer, exécutées au burin ou à la pointe sèche, ainsi que des xylographies des débuts de la Renaissance. Quelques unes de ces gravures sur bois reprenaient de frustes dessins des arcanes majeurs des tarots de Marseille - « le bateleur », « l'empereur », « le mat », « la papesse », « la force » ou « la maison-Dieu ». Le graphisme en était si naïf et grossier que ces xylogravures

évoquaient davantage la Bibliothèque bleue des Vosges, le calendrier ou almanach des bergers

ou toute autre littérature de colportage que les illustrations d'un incunable du commencement du règne de Louis XII, nonobstant les costumes des personnages.

Il a été écrit tantôt que la duchesse d'Aumale ne montrait aucun intérêt aux procédés de Niépce. De fait, sa collection comprenait deux héliographies du savant reproduisant le portrait du pape Pie VII par David ainsi qu'un physautotype semblable à une nature morte, mais en noir et blanc. Un autre objet, évocateur de la propagande napoléonienne, était entré en possession de la duchesse, au risque de faire jouer par l'immortel auteur de « Buonaparte et des Bourbons » la pantomime des fâcheux, s'il l'avait toutefois su : une tabatière de santal qui, sous son couvercle apparent représentant Notre Père de Gand, le podagre Louis XVIII, dissimulait une seconde ouverture, subversive, dont l'image était un Napoléon glorieux! Louis XVIII, ce monarque obèse dont on disait qu'à la fin de sa vie, le valet, tous les soirs, lorsqu'il lui ôtait ses bas, passait son temps à y récolter les fragments de doigts pourris rongés par la gangrène...

Pour ces dépenses somptuaires, pour ces rares collections, Marie-Caroline Auguste était accusée de jeter son argent par les fenêtres. Pour tout l'or du monde, pourtant, elle ne souhaitait aucunement que sur sa pierre tombale, on gravât l'infamante épitaphe :
« Ci-gît Marie-Caroline Auguste de Bourbon, duchesse d'Aumale, qui était mains-percées, quoiqu'en d'autres domaines, elle eût l'avaricieuse réputation d'un Harpagon, d'un fesse-mathieu et d'un pouacre. »
Au contraire de la précédente Dame, Anne-Louise Alix de Montmorency ne courait pas le risque de voir son tombeau agrémenté d'un libelle post-mortem. Elle était l'aînée du trio, car née en 1810, ce qui lui faisait trente-cinq ans accomplis en cet an de grâce 1845. En 1829, à dix-neuf ans, elle avait convolé en justes noces avec Louis de Talleyrand-Périgord, futur duc de Talleyrand. Les esprits chagrins le lui en avaient voulu, à cause de la réputation de traître de comédie de son nouveau et illustre parent par alliance, Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord. Ils moquaient ses ralliements successifs, dans le sens fort du terme, comme lorsqu'on emploie le verbe to mock dans la langue de Chaucer, sans comprendre que tous ces soi-disant atermoiements et louvoiements relevaient en fait d'un grand sens politique mis avant tout au service de la France. Ils faisaient semblant d'adresser des éloges à la jeune mariée tout en marmottant leur acrimonie sous cape. Depuis la mort de l'illustre et controversé homme d'Etat en 1838, le temps d'entonner l'air de la calomnie était passé de mode. Les hypocrites, les cagots, les capons, les persifleurs et autres flagorneurs en étaient désormais pour leurs frais, mais ils n'oubliaient pas de se remémorer la sentence de Buonaparte au sujet de l'impétrant aux multiples casaques :
« Vous êtes de la merde dans un bas de soie.»

Le regard bleu et la chevelure châtain-clair mêlée de roux et de blond de la duchesse aux boucles anglaises soyeuses avaient inspiré l'immortel portrait de Claude-Marie Dubufe, exécuté vers 1840. Madame avait posé avec sa fille.
Anne-Louise Alix alliait l'intelligence à la beauté. Fait incroyable, elle se passionnait pour l'économie politique. Cela n'était ni un euphémisme, ni même une hypallage de dire qu'elle avait réellement un don pour cette matière. Elle s'était constitué une bibliothèque où les ouvrages des mercantilistes français du dix-septième siècle côtoyaient « L'économique » de Xénophon, « La Richesse des nations » d'Adam Smith, mais aussi Malthus, Ricardo, Sismondi, Saint-Simon et Jean-Baptiste Say. Certains auteurs, séditieux, lui plaisaient moins, mais elle les avait lus assidûment avant d'arrêter sur eux son opinion : Fourier, Cabet, avec sa fameuse « Icarie » et Victor Considérant ainsi que le « père » Enfantin ne lui avaient point échappé. Comme Buonaparte, elle faisait surveiller le cinq pour cent en bourse ainsi que la valeur de la rente. Elle se préoccupait de la fiscalité, des centimes additionnels, du taux de l'escompte et des quatre vieilles dont trois étaient dues par le patrimoine des Montmorency et des Talleyrand-Périgord : la contribution foncière, la contribution mobilière et personnelle et l'impôt sur les portes et fenêtres.
Imaginons un instant uchronique au cours duquel la magnifique Anne-Louise Alix aurait été confrontée à l'ouvrage d'un siècle postérieur, « Le voyage des esclaves », du mystérieux et implacable économiste autrichien Taddeus Von Kalmann. Comment aurait-elle réagi aux affirmations péremptoires de ce pensum qui affirmait que toute intervention de l'Etat, même modérée, était la porte ouverte vers l'horreur communiste et qu'il fallait faire table rase de toutes les conquêtes sociales effectuées en un siècle, de toutes les velléités philanthropiques, faire brûler solennellement en l'équivalent américain de la place de Grève par le bourreau du coin l'enquête de monsieur Villermé et la loi de 1841 sur le travail des enfants? Et cette conclusion hideuse : « L'esclavage antique était économiquement rentable », ce « slavery is beautiful. » sacrilège! Aurait-elle battu des mains comme une fillette émerveillée par un tour de magie, ou aurait-elle jeté ledit livre à la figure de l'économiste en le traitant de plus grand malfaiteur de l'humanité depuis Néron? Elle ne pensait pas sérieusement qu'il y eût encore des bourreaux en Amérique, des sortes d'inquisiteurs protestants, quoiqu'elle eût entendu parler des oeuvres de monsieur Alexis de Tocqueville, élu à l'Académie française en 1841.
Anne-Louise Alix de Montmorency, duchesse de Talleyrand-Périgord, figurait, comme on l'a deviné, parmi les plus éclairées des bibliophiles de ce temps. Elle possédait, entre autres ouvrages d'érudition désintéressée, le fameux « Traité encyclopédique des bagues de cigares », in-octavo de maroquin vieux-rose, que les énergumènes et esprits retors les moins avertis rangeaient à cause de sa couleur parmi les livres licencieux. Le volume, dû au comte Juniper-Ildefonse de Coëtquidan-Saint-Yrieix, membre de l'Académie des Jeux Floraux de Toulouse et correspondant de l'Accademia dei Lincei, trônait orgueilleusement sur un rayonnage médian de la bibliothèque d'ébène de la duchesse, à proximité d'un bonheur-du-jour tout en marqueterie précieuse, avec ses tiroirs à secrets. Le galant petit meuble renfermait des fascicules de poupées de papier reproduites des catalogues de mode anglais du Godey's lady's book, fascicules destinés à l'éducation et aux exercices pédagogiques es-découpages aux ciseaux de la fille d'Anne-Louise, celle-là même que Claude-Marie Dubufe avait portraiturée avec sa génitrice en 1840. Sous l'influence anglomaniaque prodiguée par ces insignes Alice ou Emma de papier dites « paper dolls »,

la duchesse de Talleyrand-Périgord avait adopté l'usage des dessous d'Outre-Manche, à-savoir les « pantaloons », linge parmi les plus érotico-pudiques de tous les temps, auparavant réservé aux seules fillettes et prostituées, dont l'usage se répandit promptement dans toute la bonne société adulte, y compris ses amies la duchesse d'Aumale et la comtesse d'Haussonville, sans que les historiens du costume féminin eussent pu mesurer la part d'influence exacte d'Anne-Louise Alix dans ce fashionable phénomène.

Au contraire des découpages enfantins, les leçons de musique prodiguées à mademoiselle de Talleyrand-Périgord représentaient à ses yeux autant de supplices chinois, quoique ses parents pensassent le contraire. Sous la férule d'un vieux professeur atrabilaire qui croyait imiter ainsi les maîtres de musique chers à monsieur Jourdain, la pauvre enfant subissait force châtiments corporels, fustigations, frappes digitales on ne peut plus douloureuses prodiguées par une badine de jonc ou de bambou à chaque faute commise par l'apprentie musicienne. C'était à croire qu'elle eût été destinée à un nouveau martyrologe patristique, prolégomènes d'une pédagogie de la souffrance stoïque dont le principe était de rentrer de force savoir et pratique! Le maestro utilisait d'inappropriés traités de solfège, leçons ardues de messieurs Panseron

et Fétis,

que monsieur Berlioz vouait alors aux gémonies dans maint article du « Journal des Débats ». Les deux auteurs le lui rendaient bien, et leur détestation mutuelle était chose publique! Comment une fillette aussi jeune pourrait-elle assimiler des morceaux chantés de solfège écrits sur les sept clefs, avec des changements dans toutes les clefs? L'art de monsieur Panseron poussait jusqu'à la caricature ce style virtuose et fleuri du « bel canto » Restauration, jà évoqué plus haut à propos des impétrants Spontini et Paer, tandis que monsieur Fétis, directeur du conservatoire de Bruxelles de la jeune nation belge, pondait d'improbables morceaux de concours inspirés disait-il des maîtres anciens de l'école franco-flamande du seizième siècle! Le musicologue l'emportait las en lui, au détriment du pédagogue!
Restait la troisième noble Dame, née le 25 mai 1818 : Louise-Albertine de Broglie, comtesse d'Haussonville depuis le 10 octobre 1836. Personne la plus intéressante du trio, elle était réputée pour ses idées orléanistes libérales, tout comme monsieur Victor Hugo, nouveau pair de France, s'était un temps proclamé « royaliste libéral ». Pour cela, Horace de Viel-Castel la haïssait, car il connaissait son inimitié envers le prince Louis-Napoléon, le neveu de Buonaparte, alors détenu pour sédition au fort de Ham. Ce violent contempteur de la monarchie libérale, expert en fiel acerbe, en admonestations et en anathèmes, dont on ne sut plus s'il était un légitimiste pur et dur ou un thuriféraire du futur Empire autoritaire, écrira dans ses Mémoires, à la date du 22 février 1852 :

« Ces d'Orléans sont une race maudite. C'est cette race qui a toujours préparé depuis plus de soixante ans toutes nos révolutions. Le châtiment tombe à la fin sur elle, c'est justice.
Bocher, administrateur de leurs biens, ancien préfet, ancien député, est arrêté sous l'accusation de s'être fait le distributeur de leurs pamphlets. Madame d'Haussonville,chez laquelle a eu lieu une perquisition, tenait le dépôt de ces pamphlets, il y en avait de gros ballots dans ses appartements et jusque dans sa voiture.
M. d'Haussonville le fils, qui a épousé Mlle de Broglie, s'est fait expulser de la Belgique où il publiait un journal rempli de mensonges sur les affaires de France. Ce journal se nommait : « Les bulletins français » ».
L'impétrante aux bandeaux châtains dorés et aux grands yeux dormeurs était la plus potelée de nos trois héroïnes. Daisy-Belle de Beauregard, une grande actrice anglo-américaine du siècle suivant, l'aurait idéalement interprétée à l'écran. En cette année 1845, elle posait pour Jean Auguste Dominique Ingres, le plus remarquable des trois portraitistes cités. Madame était dans cet état qu'Outre-Manche on appelle pregnancy, chose d'une durée de neuf mois, que nos lionnes des boulevards, que nos lorettes, savent éviter lorsqu'elles se mettent en ménage avec un dandy anglais. Les rencontres sentimentales se nouaient depuis peu au fameux bal Mabille, dont L'illustration, revue à laquelle Louise-Albertine s'était abonnée dès le premier numéro, deux ans auparavant, rendait compte en de pittoresque articles. La comtesse d'Haussonville appréciait aussi cette série de fascicules fameux consacrés aux Français peints (ou vus) par eux-mêmes, qui, depuis le début des années 1830, constituaient une extraordinaire galerie sociale, une étude exhaustive de caractères, une sorte de Comédie Humaine imagière et textuelle fixant pour la postérité les archétypes de ce temps.
Louise-Albertine de Broglie était née à Coppet, l'ancienne résidence de madame de Staël, fille de Necker, le fameux ministre de louis XVI. Elle était leur descendante, mais les Broglie avaient leur hôtel particulier au 15 rue Dominique. Plus tard, l'intéressée recevrait le sobriquet de « Charles de Valois en jupons.» Charles de Valois était célèbre au quatorzième siècle pour avoir été qualifié de fils de roi, frère de roi, oncle de roi, père de roi et jamais roi. Le surnom de Louise-Albertine de Broglie trouvera sa justification vers la fin du siècle, du fait qu'elle fut fille d'académicien, soeur d'académicien, épouse d'académicien, mère d'académicien et jamais académicienne, la docte compagnie étant fermée aux femmes!
Elle aurait pu se contenter d'un statut de potiche, se replier sur sa chaufferette, devenir une vieille atrabilaire en savates et buvant sa tisane, de ces femelles acariâtres à l'encontre desquelles au Siècle des Lumières, maroufles, coquins, paltoquets et autres écornifleurs adressaient leurs invectivantes injures sous la qualité de « savates de tripières » et autres « sale huppe ». Elle se serait accommodée de la lecture dans le texte des comédies grecques d'Aristophane ou de Ménandre, qui oeuvra à Athènes sous la dictature de Démétrios de Phalère, voire comme l'Empereur bègue Claude, se serait entichée d' étruscologie. Mais voilà : l'atavisme libéral des Necker prit en elle le dessus! Elle écrira certes, des ouvrages érudits sur Byron, par exemple. Mais, pour l'heure, elle choisit de s'intéresser aux arts décoratifs, particulièrement à la céramique, à la miroiterie, à la tapisserie et à l'ébénisterie. Elle hantait de sa jolie présence la manufacture de Sèvres, les Gobelins et Saint-Gobain. Son indiscrète oreille y captait les potins défavorables au gouvernement, la température de la France besogneuse, tâtant le pouls du peuple, telles les sinistres mouches, ces espions de la police secrète impériale tout dévoués aux Fouché et Savary. Elle apprit que Monsieur Guizot, surnommé « la borne », exaspérait de plus en plus ceux qui, sans cens ni capacités, étaient exclus du droit de vote. Elle sentit lever dans les ateliers d'ébénistes les nouveaux ferments et levains républicains. Les émeutes antifiscales de l'été 1841, survenues, comme des émotions populaires de turlupins d'Ancien Régime, à cause de la réforme de l'assiette de l'impôt sur les portes et fenêtres, étaient dans toutes les mémoires, et les braises brûlaient encore.
Il fallait bien cependant qu'en ces manufactures ou ces boutiques d'antiquaires, elle achetât quelque chose. Ce fut pourquoi ses appartements s'encombrèrent jusqu'aux combles de ses turlutaines, d'un capharnaüm de cocagne. Elle chinait à longueur d'année, baguenaudant et bibelotant à tout crin, dans le sens littéral du terme, à la recherche de l'objet, de la friolerie ou du meuble incongru, quêtant l'antiquaille originale, même si parfois, l' antiquaillerie était proche de la quincaillerie. De cauteleux escrocs, de vilains patte-pelus, ces princes des chats-fourrés à la Grippeminaud, la bretaudèrent et la décavèrent quelques fois. Ces attrape-minette, bien qu'elle eût jà vingt-sept ans, l'emberlicoquèrent, l'embobelinèrent et lui vendirent ainsi qui une collection de cornets acoustiques burlesques en simple étain plaqué or, de ceux que l'on nommerait « bigophones » à la fin du siècle, qui une happelourde présentée comme un diamant du Canada, qui une croûte insane montrée comme la toile d'un maître de l'école hollandaise, en fait une tartouillade peinte à l'eau par le dernier des barbouillons. Certains des cornets cités ci-dessus avaient des formes saugrenues en têtes de lions, de dragons et autres membres des bestiaires fabuleux, rappels des trompes ou carnix des guerriers gaulois au service des Brennus et Ambicat.
Elle voulait acquérir ces objets ribon-ribaine, ne regardant aucunement à la dépense! Son humeur demeurait badine et équanime, ne s'offusquant jamais de ces forfanteries. Le résultat était là : causeuses, buffets Henri II, commodes, armoires, bergères, « confidents-de-ces-dames », coiffeuses, petits-pieds, boudeuses,

demi-bains, bercelonnettes (pour son futur enfant),

ottomanes, liseuses, lectrins,

fauteuils, faudesteuils, lutrins, sambues,

monte-escaliers et chaises de tout lieu et toute époque. Parmi toutes ces coquecigrues meublantes, parfois trouées des repas des xylophages, en bonne partisane du beylisme, elle était particulièrement fière de la possession d'une chaise à porteurs ayant, disait-on, appartenu à Lauzun et d'une caquetoire pour nains, fous du Roy ou menines, destinée à quelque foutriquet, poulpiquet ou Triboulet de la cour de France, dont le siège était si rugueux pour votre fondement que ledit fauteuil finissait par faire office de chaise à écorche-cul. A côté des légions de céramiques, porcelaines et faïences de Chine, de Sèvres ou d'ailleurs, des armadas de glaces et de psychés, de tapisseries d'Aubusson, de tapis persans tout râpés et fanés des temps séfévides de Shah Abbas, sans omettre une reproduction à l'ibidem de la tapisserie de la Genèse de Gérone,

Louise-Albertine, comtesse d'Haussonville montrait à tout visiteur qui le voulait bien ses armées de porte-flambeaux de bronze, de bois ou de stuc, ses lampadophores sculptés ou moulés des règnes de Louis XIV, XV et XVI.

Il y avait des statues d'ours et de singes affreux, vilains magots de Berbérie et sapajous, mal chapeautés, tout déparpaillés, crocs dehors, au bronze patiné et vert-de-grisé, des esclaves nègres enturbannés à la turque, aux coloris trop vifs, excessifs, qui les apparentaient à ces arts émergents, « chic » du pauvre et du bigot, de la crapaudière de bénitier, que l'on avait baptisés des noms pédants de chromolithographie et d'art saint-sulpicien, lorsque le plumitif préposé au dictionnaire des néologismes versait dans le cataglottisme au risque de la cacographie.
Un soir, alors qu'elle montait en calèche après avoir papoté avec une descendante de la comtesse de Verrue, Louise-Albertine avait malencontreusement brisé le céladon Song qu'elle venait d'acquérir en s'asseyant dessus. Un vase à sept cents francs! L'ampleur grandissante des jupes y était pour beaucoup. Elle n'eut d'autre ressource que de faire passer le bibelot pour une nouvelle manière de casse-tête chinois, de baguenaudier de porcelaine en multiples morceaux, à reconstituer, de ce que les joueurs d'Albion appelaient puzzle.
Entre-temps, elle songeait déjà aux jouets de son futur enfant. Cela lui permettait d'oublier son acrimonie envers ceux qui l'avaient grugée, qui avaient abusé de sa supposée sottise juvénile, de son côté béjaune, ces Trissotin, ces Papotin, ces calotins, ces fricotins, ces racle-martingale et autres trousse-carcaille, affamés de son or, dont le passe-temps favori était de soutirer les espèces sonnantes et trébuchantes jusqu'à l'abîme de son réticule, de sa bourse de bon cuir de Cordoue, jusqu'à ce qu'il n'en restât pas le moindre liard.
Plutôt que les hochets, Louise-Albertine aimait à acquérir pour sa progéniture des jeux pour enfants plus âgés. Elle acheta ainsi des marionnettes à gaine lyonnaises, des répliques du Guignol de Mourguet, en un format particulier confinant à l'anomalie, s'assurant lors de la livraison qu'aucune de ces bamboches ne manquât à l'appel. Elle souhaitait constituer un théâtre de marionnettes pour ses enfants, à l'image de celui de Madame George Sand. Elle le fit fabriquer par des menuisiers compagnons du tour de France. Parmi d' autres acquêts de cet acabit, Louise-Albertine fit importer à grands frais d'Italie des polichinelles et des paladins siciliens en armures maximiliennes à moufles, casqués de bicoquets et d'armets du second type, héros à fils et à tringles de Turold, du Tasse et de l'Arioste. Enfin, droit d'Alsace lui fut livré tout un pandémonium, une démonomanie, une légion de Belzébuth de marottes de diables, croque-mitaines et autres Père Fouettard, marouflés de tissu, tous noirs à souhait!



