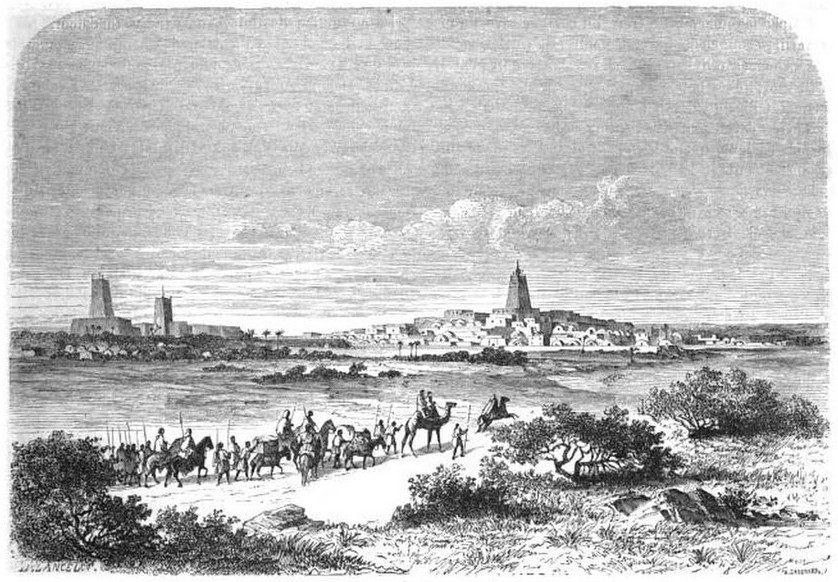Café Littéraire d’Orange, exceptionnel, du jeudi 6 novembre 2025
Listes des livres lus et choisis
parmi ceux sortis à la rentrée littéraire de septembre 2025.
Ils ont été présentés par des sympathisants du Café Littéraire, avec la
complicité de La librairie Orange Bleue et son club de lecture l’A.D.N
*****
– « Toutes les vies » – C’est un deuxième roman de Rebeka Warrior aux Éditions Stock, – Un livre écrit comme une partition, une belle histoire de couple, une belle auto-fiction.

– « Quitter la vallée » de Renaud de Chaumaray, au Éditions
Gallimard – C’est un 2ème roman - Au
cœur du Périgord, dans la vallée de la Vézère,
dans un lieu resserré, vert et minéral, Clémence et son fils trouvent
refuge dans une maison isolée. Il est question de la disparition du garçon.
Dans ce livre, trois destins, avec trois duos : le premier : mère et fils, le deuxième : père et
filles, le troisième : deux jeunes gens : lui, agriculteur, elle, une
femme libre.
Les intrigues avancent. Suspense. La fin
nous révélera les liens entre les trois histoires.

– « Sous leurs pas les années » de Camille Bordenet aux Éditions Robert Lafont. Premier roman pour cette journaliste au quotidien « Le Monde ». Le thème : deux femmes « ennemies », l’une de la Capitale, l’autre de la Campagne. Écriture vibrante. C’est un coup de cœur de la lectrice.

– « Monsieur Mouche » de Claude Alain Arnaud aux Éditions de la Dilettante . C’est un roman réjouissant qui prend le parti des opprimés. Il y a aussi de la vengeance dans « Monsieur Mouche », mais ce n’est pourtant pas son genre. Monsieur Mouche est professeur de français, qui ne ferait pas de mal à une mouche. C’est peut-être un ange gardien qui va s’occuper de le venger.

– « La maison vide » de Laurent Mauvignier aux Éditions de Minuit. Dans "La Maison vide", Laurent Mauvignier tisse l'histoire de famille à partir de souvenirs récoltés, une fiction à partir du réel.

– « L’ADN fantôme - Quand l’invisible laisse des traces » de Benjamin Allegrini aux Éditions « Les liens qui libèrent ». Le domaine des sciences naturelles connaît une révolution sans précédent grâce à l'ADN environnemental : à partir d'échantillons d'ADN prélevés dans les milieux naturels, les scientifiques sont aujourd'hui capables de saisir l'invisible et d'identifier tous les êtres vivants qui ont traversé le milieu étudié. Une incroyable avancée qui permet un voyage dans le temps et change radicalement notre rapport à la biodiversité.

– « France, album de Famille » de Yann Arthus Bertrand aux Éditions - Ces trois dernières années, Yann Arthus-Bertrand a promené son studio itinérant aux quatre coins du pays et immortalisé pas moins de 30 000 personnes, en solo, en équipe ou en famille. Il offre un panorama en 800 photos, éclairées de légendes écrites grâce au travail d’Hervé Le Bras.

– « Trois fois la colère » aux Éditions Le Sonneur - Sixième roman de Laurine Roux. C’est une fresque médiévale où l’on suit le destin de trois enfants séparés à la naissance et d’une myriade de personnages, dont la nature, à la fois symbole de l’amour, de l’espoir et de la révolte. Tout en remontant la généalogie de cette histoire de pouvoir, de vengeance et de justice au temps du Moyen-Âge, Trois fois la colère s’empare de quelques-unes des questions qui taraudent notre modernité : la domination masculine, le hiatus entre la justice et la vengeance, la tension entre l’empire du passé et les identités à inventer.

– « La marchande d’oublies » de Pierre Jourde - Cette histoire se déroule à la fin du XIXᵉ siècle, dans le cirque, les foires, les baraques aux monstres. Une famille de clowns-acrobates, les Helquin, quatre frères et leur sœur Thalia, donne des spectacles macabres et inquiétants. Le benjamin, le plus doué et le plus violent, perd la raison et disparaît. Tandis que Charles, un médecin aliéniste, tombe sous le charme de la jeune sœur, et s’enfuit avec elle.

–
« La bonne mère » de Mathilda Di Mattéo aux Éditions Iconoclaste.
C’est un premier roman. Un roman
drôle. Il s’agit d’une rencontre en deux milieux. « La bonne mère » a déboulé dans
cette rentrée littéraire avec l’accent de Marseille collé aux pages. La mère,
Véro, entière, excessive, sensuelle ; elle est droitière du franc-parler et gauchère de la diplomatie. Sa
fille Clara, plus posée, plus
cérébrale,est montée à Paris pour
intégrer Sciences Po et chercher son
indépendance.
Lorsqu’elle revient ce week-end là, c’est
pour présenter à ses parents son amoureux Raphaël. Un parisien peuchère ! Immédiatement, Véro déteste tout
de lui : sa façon de s’habiller, de
s’exprimer, de regarder. Elle l’appelle le girafon.Un texte rafraîchissant, drôle qui sait tirer
son épingle du jeu en abordant des
thématiques difficiles, avec une fin
délicate.

– « L’homme qui lisait des livres » de Rachid Benzine aux Editions Julliard. Après le succès de son roman « Les Silences des pères », Rachid Benzine signe une fable délicate, poétique et engagée, c’est l’histoire d’un libraire à Gaza et, à travers ce personnage, l’histoire meurtrie d’un pays. À l’instar de « L’homme qui plantait des arbres » de Giono auquel il fait référence dans son titre, Rachid Benzine propose avec clarté et intelligence une fable contemporaine sur le pouvoir des mots face à la barbarie.

– « Et toute la vie devant nous » de Olivier Adam aux Éditions Flammarion – Dans cet ample roman qui embrasse l’histoire de trois amis, Olivier Adam traverse les époques en faisant résonner l’intime et le collectif, et met au jour ce que l’amitié grave d’indélébile dans nos vies. Une approche sociologique de quarante années d’amour.

–
« Haute folie » de Antoine Wauters aux Editions
Galimard - Ce court roman est une maison de
famille, une ferme, et le narrateur nous prévient dès la première page :
"Toute notre histoire tient dans son nom". Cette histoire, c’est celle de Blanche et Gaspard,
de leur fils Josef, enfant de malheur,
né le jour où la ferme prend feu. C’est le début du roman : un incendie, Gaspard y perd sa maison, une
partie de ses bêtes, sa dignité ;
et quand pour survivre, il se met à chercher un nouveau travail, il sera escroqué, humilié - bref, le
voici porteur d’une histoire familiale,
qui est une malédiction.
Ce livre a fait l’unanimité au sein du groupe de
lecteurs (ADN). « Une tragédie antique », dit l’un d’entre-eux.
« Belle écriture ciselée - poétique ».

– « La collision » de Paul Gasnier aux Éditions Gallimard. C’est un premier récit, un roman bien ancré dans des problématiques de notre société. Dans « La collision », Paul Gasnier retrace la trajectoire d’un fils endeuillé par la mort tragique de sa mère dans un accident de la route. En juin 2012, la mère du narrateur, 54 ans, se rend à son travail à vélo. Sur le chemin de son travail, elle est fauchée par un jeune homme de 18 ans qui pilote une moto non immatriculée en exécutant une roue arrière à 80 km/h. Récidiviste, sans permis de conduire, Saïd a emprunté cette moto après avoir fumé du cannabis. « La collision » tient place à la Croix-Rousse à Lyon, un quartier apprécié pour sa mixité urbaine. « Un texte intelligent, un joli témoignage ».

– « De l’autre côté de la vie » de Fabrice Humbert - Un homme parle. Il raconte sa fuite hors de Paris, avec ses deux enfants.
La ville, en proie à la guerre civile, est en feu. Il veut rejoindre une République du Jura sans
doute illusoire. Dans un pays dévasté
par le conflit, sa seule mission doit être de préserver les siens de la cruauté. La route, parcourue en
voiture, à dos d’âne et souvent à pied,
sera longue. Elle sera semée de dangers
mortels, illuminée par la beauté de certaines rencontres. À travers champs, à travers bois, il tâche de se
raccrocher à ce qu’il peut conserver
d’humanité et d’amour.
Ce roman haletant aux allures de
conte ou de rêve évoque autant notre pays que l’itinéraire d’un homme vers l’essence de la vie.

– « Une pieuvre au plafond » de Melvin Melissa - C’est un Premier roman – C’est le récit d’un couple, d’un trouple. Parmi les « déglingués » des Hauts-de-France, Sibylle et Simon mènent une vie marginale, faite d'art et d'excès. Leur quotidien oscille entre élans artistiques et angoisses du lendemain. Lorsqu'ils rencontrent Haroun, leur relation prend un nouveau tournant : l'aventure d'un soir se transforme en une passion dévorante. Ensemble, ils décident de former un trio qui défie les normes établies. « C’est un livre très lumineux ».

– « Au grand jamais » de Jakuta
Alikavazovic –
La romancière, prix Goncourt 2008 du premier roman, décortique les
mécanismes de la transmission à travers un portrait tout en délicatesse, plus
vivant que jamais, de sa mère récemment disparue.
"À propos de ma mère, j'ai adopté
une histoire, une esquisse de vie, et j'y ai adhéré. Cela m'allait."
Mais que sait-on réellement de nos mères ? Dans Au grand jamais Jakuta Alikavazovic revisite son enfance pour
tenter d'élucider l'énigme que fut pour elle sa mère poétesse. Un portrait hanté
par les fantômes de l'exil doublé d'une passionnante réflexion sur les chemins
détournés qu'emprunte parfois la création artistique. C’est un roman sur
l’identité, l’exil, la mémoire, la transmission.

– "La Nuit au cœur" de Natacha Appanah, prix Femina 2025 : « Il ne faut pas avoir peur de se plonger dans ce roman » nous dit Emmanuelle, notre libraire, même si le thème est difficile, ce livre est très important. » C’est une plongée vertigineuse dans l'enfer des violences conjugale À travers les destins croisés de trois femmes victimes de la violence de leur compagnon, la romancière de "Tropique de la violence" explore les mécanismes destructeurs de l'emprise dans son récit le plus personnel. Bouleversant.

*****
Annie Guillet, une habituée de notre Café Littéraire, nous parle d’un film « lumières pâles sur les collines » adapté du roman éponyme paru en 1982, de Kazuo Ishiguro, Prix Nobel de littérature en 2017. Ce nouveau film de Kei Ishikawa magnifiquement interprété par des actrices Suzu Hirose et Fumi Nikaido auxquelles on peut adjoindre Yō Yoshida et Camilla Aiko, dignes de Mizoguchi, dans une lumière et une photographie impériales dues à Piotr Niemyjski, fait mouche. A Man, Lumière pâle sur les collines, de facture presque académique, propose une histoire précise et efficace du Japon depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale à travers la terrible blessure de Nagasaki d’où viennent les personnages féminins du film. Un terrible choc pour ce pays allié jusqu’au bout des nazis, irradié par les Américains, et obligé de survivre à travers tradition et modernité. (article extrait de « Il était une fois le cinéma).